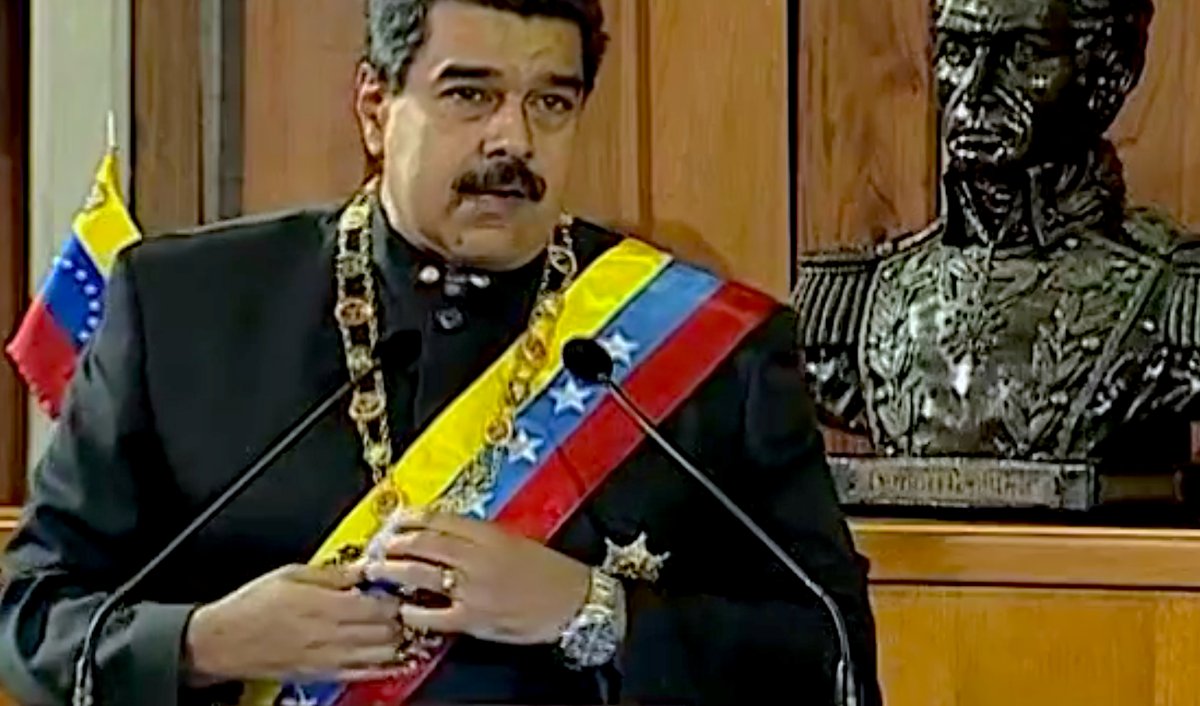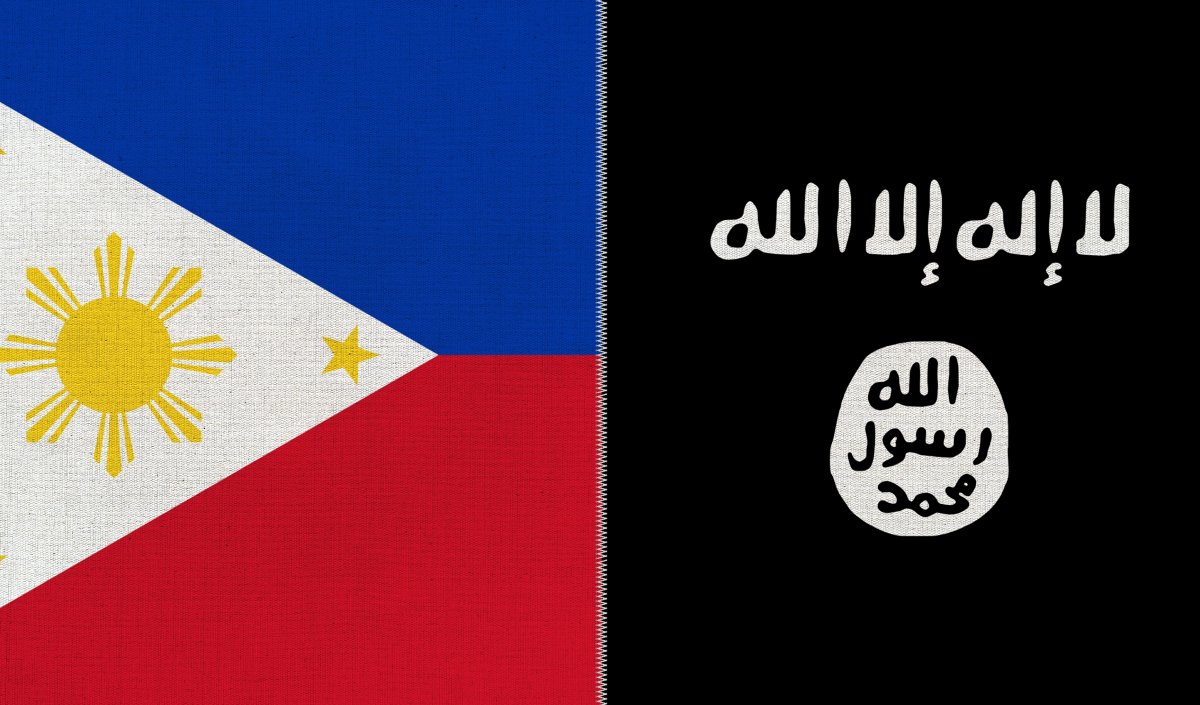Un traité mondial, une gouvernance sanitaire et peu de débats
Une démarche saluée comme « historique » par l'OMS, l'ONU et la majorité des grands médias, qui y voient une avancée vers une meilleure coordination internationale et une plus grande prévenance vis-à-vis des pays du Sud. En France, Libération évoque un accord pour « mieux protéger le monde », France Info, le Figaro ou encore Ouest France reprennent quant à eux les termes officiels. L'OMS a annoncé la rédaction du traité via notamment cette vidéo au ton grave.
Ce traité (dont vous retrouverez la dernière version en sélection) soulève de nombreuses questions, car il s'inscrit dans l'héritage Covid, sans jamais le questionner. Comme l'origine du virus, longtemps attribuée au pangolin, alors que la thèse privilégiée pointe désormais une fuite de laboratoire menant des recherches sur le « gain de fonction » (procédé visant à rendre un virus plus contagieux ou dangereux pour mieux l'étudier), ou les politiques de confinement et de vaccination massive. Sans oublier le vaccin lui-même, ses effets dans le temps, le procès contre Mme Von der Leyen pour les négociations opaques avec Pfizer, les achats controversés de traitements comme le Remdesivir ou le Paxlovid ou encore le scandale Lancet sur l'hydroxychloroquine…
Cette période a laissé une empreinte que beaucoup semblent avoir (ou vouloir) effacer. Il paraît pourtant essentiel de la regarder en face. Certaines voix critiques, comme celle de la psychologue Marie-Estelle Dupont, la voient comme un point de bascule civilisationnel, un « glissement totalitaire », estimant que les crises sanitaires deviennent le prétexte d'un contrôle toujours plus poussé des populations. « Les crises ne sont plus qu'un support narratif pour justifier ce contrôle. Au nom du bien, le pire du totalitarisme sera autorisé », affirme-t-elle.
Si les négociations actuelles impliquent les 194 États membres, elles sont dirigées en pratique par un bureau restreint. Il est composé de six pays, que sont la France, représentée par Anne-Claire Amprou (coprésidente), l'Afrique du Sud (coprésidente), le Brésil, l'Égypte, la Thaïlande et l'Australie. Ce sont eux qui orientent l'avancée des négociations. Les autres États réagissent, amendent ou valident. Normalement, selon l'article 19 de la Constitution de l'OMS, l'adoption d'un traité requiert une majorité des deux tiers des États présents et votants à l'Assemblée mondiale de la santé.
Mais la procédure est différente pour ce texte, car, selon l'article 35, « Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès du dépositaire ». Il suffit donc que 60 pays le ratifient pour qu'il soit adopté.
Si le traité reconnaît dans l'article 1 que « les États portent la responsabilité première de la santé de leurs populations », plusieurs dispositions soulèvent des inquiétudes sur une potentielle dilution de cette souveraineté. Parmi lesquels :
-
L'article 12 institue le PABS (Pathogen Access and Benefit-Sharing System), un système mondial contraignant le partage des agents pathogènes. C'est le cœur du projet. Chaque pays devra transmettre rapidement ses échantillons biologiques à un réseau de laboratoires et centres désignés par l'OMS. Il instaure une logique de circulation verticale puisque les agents pathogènes remontent vers un centre et les décisions redescendent. Un dispositif présenté comme solidaire, mais qui pourrait, dans la pratique, creuser davantage les inégalités d'accès à la recherche, à l'innovation et aux moyens de lutte sanitaire.
-
L'article 17, consacré à la gouvernance, plaide pour une approche « gouvernementale et sociétale globale ». Il engage les États à aligner l'ensemble de leurs institutions publiques et privées dans la réponse aux pandémies, sur les décisions de l'OMS.
-
L'article 21, portant sur la création d'une Conférence des Parties (CoP), instaure un nouvel organe décisionnel. Inspiré du modèle des COP climatiques, il aurait le pouvoir d'interpréter et d'amender le traité. Ses décisions pourraient s'imposer aux États dans un cadre à la légitimité démocratique discutable.
-
L'article 18, souvent sous-estimé, aborde la lutte contre la désinformation. Il confère à l'OMS le pouvoir de définir ce qu'est la « bonne information » pendant une crise. Les États s'engagent ainsi à « prévenir la désinformation et la stigmatisation » et donc encadrer les discours dissidents. « En application des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'OMS fournit, selon les besoins et sur demande, un appui technique aux Parties, en particulier aux pays en développement, pour la communication et la sensibilisation du public aux mesures liées à une pandémie ». Dans les faits, elle pourrait encadrer, voire standardiser les messages publics à travers le monde, s'arrogeant ainsi un quasi-monopole sur la communication.
Ce traité dessine une gouvernance sanitaire mondiale plus centralisée. L'OMS serait seule à pouvoir déclencher l'état d'urgence, activant ainsi son propre dispositif, sans réel contre-pouvoir. La question paraît alors limpide, faut-il lui confier, seule, les clés du camion ? Libre à chacun de répondre, mais ça ressemble à un ajustement post-Covid, visant à mieux contrôler ce qui lui avait échappé.