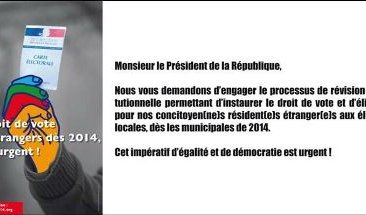« La ruée vers l'or » : le premier plaidoyer de « Charlot » contre les temps modernes
Il y a tout juste 100 ans (le 26 juin 1925 exactement), sortait l'un des premiers chefs-d'œuvre d'Hollywood : « La ruée vers l'or ». Pour Charlie Chaplin et son personnage fétiche – le vagabond « Charlot » – ce fut une consécration pour celui qui allait devenir l'une des premières stars mondiales du cinéma. À cette occasion, une version restaurée de ce film muet revient dans les cinémas. Derrière le personnage attendrissant d'innocence de « Charlot » (« Tramp » : le « vagabond » selon le titre original), c'est une critique virulente de l'individualisme prôné par le libéralisme anglo-saxon. Toute la carrière de Chaplin sera d'ailleurs construite autour de ce personnage qui va ensuite dénoncer l'asservissement de l'homme à l'usine (« Les temps modernes » en 1936). La montée du totalitarisme (« Le dictateur » en 1940) sera un autre marqueur de la carrière de Chaplin, même s'il abandonne le personnage de « Charlot » pour devenir un petit barbier juif. Avec « La ruée vers l'or », Chaplin met à bas le « rêve américain » quelques années avant la grande crise de 1929. Il dénoncera ensuite le productivisme prôné tant par l'Amérique des années 30 que par l'Union soviétique stakhanoviste (« Les temps modernes »), pour enfin annoncer le cataclysme de la Deuxième Guerre mondiale (« Le dictateur »).
Dans « La ruée vers l'or », Charlot fait partie de la meute d'aventuriers qui se précipitent dans la région du Klondike au nord-ouest du Canada dans les années 1890. La rumeur disait que des quantités d'or dormaient sous les roches. Dans la réalité, bien peu sont revenus riches et nombre de ces chercheurs d'or y ont laissé leur peau, emportés par les maladies, les avalanches et la violence. Dans le film, l'innocent et maladroit vagabond allait tomber pile sur le filon tant convoité : non pas grâce à son ingénuité ou à son travail acharné, mais par le concours d'une terrible tempête de neige déplaçant sa misérable cabane au bon endroit ... On a là le fil conducteur de Chaplin dans une Amérique des années 20 obsédée par l'enrichissement : c'est d'abord la chance ou la destinée qui permet à un pauvre de devenir riche. Le « rêve américain » fonctionne surtout pour ceux qui sont dotés d'un solide héritage, et puis il y a quelques chanceux – pas plus méritants que la foule des gens travailleurs. « Charlot » est obligé de cuire et manger sa propre chaussure avant que le petit miracle se produise. Chaplin aimait à rappeler que « l'individualisme forcené réussit à quelques chanceux en laissant des foules en haillons ». Ce film – dont le génie comique fonctionne toujours – n'a rien perdu de sa pertinence en 2025 dans un monde occidental où la richesse des plus fortunés poursuit une courbe exponentielle quand les classes moyennes s'appauvrissent.
Charlie Chaplin n'a jamais oublié d'où il venait : une enfance à la Dickens dans les rues de Londres. Un père absent et une mère qui finit enfermée dans un asile pour aliénés... Il a témoigné plus tard que, dès l'âge de 7 ans, il s'était rendu compte que – dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle – « la pauvreté était un crime. » Et qu'au lieu d'atteindre une gloire mondiale, il aurait pu « finir dans une fosse commune ». Le destin de Chaplin épouse néanmoins parfaitement le « rêve américain » : arrivé en Californie à 24 ans sans un sou, il deviendra l'un des hommes les plus riches du monde juste 4 ans plus tard. Car – s'il était doté d'un talent extraordinaire – c'est un travail acharné qui l'a mené au sommet de la gloire. Il aurait pu alors choisir la voie de la facilité : épouser totalement ce que l'Amérique voulait voir en lui, c'est-à-dire le rêve américain personnalisé. Or, son alter ego « Charlot » restera fidèle au pauvre hère de son enfance, comme pour redonner une dignité au gamin qu'il avait été et à tous ceux qu'il avait croisés dans les rues de Londres. Sigmund Freud lui-même a commenté son parcours en arguant que Chaplin ne faisait qu'inlassablement remettre en selle l'innocence et la misère de ses jeunes années. Et l'humour était sa plus grande arme : « Nous devons rire de notre impuissance face aux forces de la nature, ou devenir fous... »
« Charlot » est le premier antihéros d'Hollywood, et son génie subversif n'a pas échappé au FBI. Dès 1922, la police américaine l'a soupçonné « d'idées socialistes ». En 30 ans, le FBI alimentera le « dossier Chaplin » de presque 2 000 documents. La critique du capitalisme fut ensuite assimilée, avec le début de la guerre froide et les années de « maccarthysme », à des sympathies communistes. Charlie Chaplin était devenu tellement gênant, que la justice américaine a pris le prétexte de sa vie privée tumultueuse pour lui interdire l'entrée sur le sol américain en 1952.
Qui pouvait sérieusement croire que Chaplin – le réalisateur et l'interprète star du « Dictateur » – fût communiste ? Il était seulement convaincu que la loi du marché devait rester assujettie à un pouvoir politique démocratiquement élu... Un crime pour l'Amérique matérialiste et triomphante des « 30 glorieuses ».