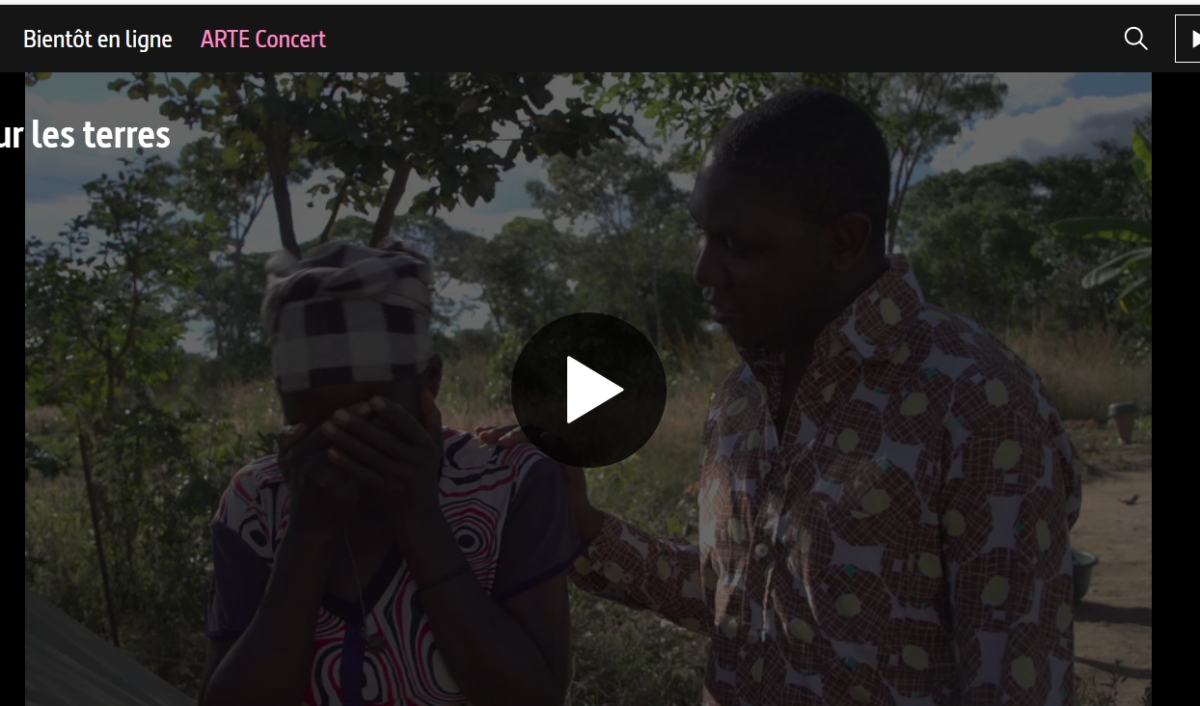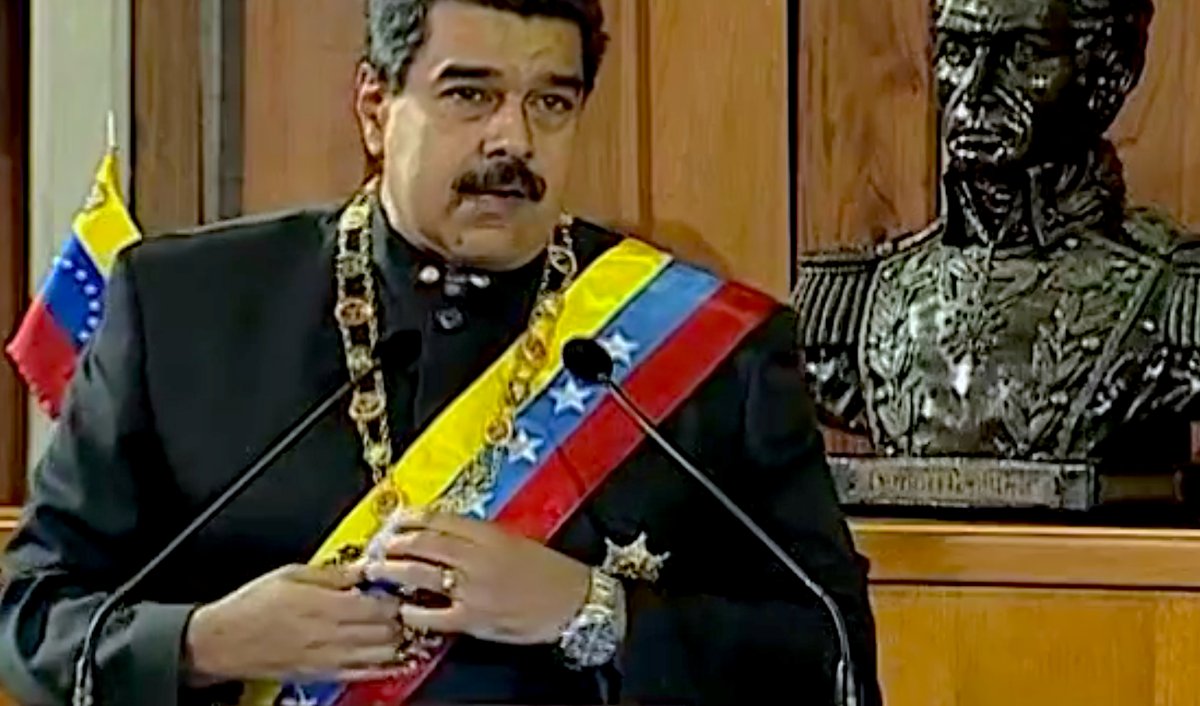Accaparement : ces terres que le monde s'arrache en secret
Les pays du Golfe font face à une obsession majeure : nourrir leurs habitants, malgré leurs carences en eau. C'est dans ce sens que l'Arabie saoudite, qui fut le sixième producteur mondial de blé avant d'épuiser ses nappes phréatiques, et les Émirats arabes unis cultivent des terres dans l'Arizona. Par les sociétés Almarai (+ de 5 000 ha) et Al Dahra (~12 000 ha), elles importent de la luzerne pour nourrir les élevages nationaux. La population locale en a subi les conséquences, ils ont pompé massivement l'eau, pénalisant les habitants des alentours.
Derrière cette pratique de l'accaparement, souvent blanchie par des accords entre États, de petits agriculteurs subissent les effets collatéraux d'une exploitation à outrance, parfois jusqu'à expulsion des terres qu'ils ont cultivées depuis des générations. (Voir notre sélection).
Un continent est particulièrement convoité pour ses surfaces agricoles : l'Afrique. Il y a en effet un double avantage : l'Afrique contiendrait environ 60 % des terres arables non exploitées (industriellement) de la planète. Et les titres de propriété sont rares. Les locaux les cultivent en petites communautés.
Dans les années 2010, l'Arabie saoudite développait un immense projet de culture du riz à Gambella (Éthiopie). C'était sans compter sur les Anuak, présents sur place. Certains se sont révoltés et ont attaqué l'enclave en 2012, faisant plusieurs morts. Pour s'implanter en Afrique, face à l'instabilité des territoires et les habitants mécontents, les multinationales ont compris qu'il fallait de la sécurité.
C'est là qu'interviennent les sociétés militaires privées. C'est la raison d'être, par exemple, de Frontier Ressource Group (FRG), un fonds d'investissement basé à Abu Dhabi et créé par Eric Prince, jadis à la tête du groupe de mercenaires Blackwater, sous la coupe de la CIA. Ce personnage fascinant est derrière un empire opaque de sociétés spécialisées dans la logistique et la sécurité. Soudan, Somalie, Yémen, Haïti, Équateur, République Démocratique du Congo : Eric Prince est souvent présent là où règne le chaos. Il travaille également pour la Chine, où il a établi des liens avec le secteur technologique (ainsi qu'en Ukraine). Il a été financé secrètement par le Sheikh Tahnoon, frère du président des Émirats. Ce dernier dirige la First Abu Dabi Bank et ADQ (un fonds souverain ayant acquis des parts dans de nombreux géants de l'industrie agricole). Eric Prince a reçu plus d'un demi-milliard de dollars, afin de mettre en place une armée de mercenaires au service des intérêts émiratis, notamment en Afrique.
Les Émirats savent que les printemps arabes ont été en partie la conséquence d'une crise alimentaire dont ils veulent à tout prix éloigner le spectre. En 2018, ils ont donc lancé une stratégie de sécurité alimentaire, combinant investissements étrangers et nationaux. Objectif : figurer en 1re place de l'indice mondial de sécurité alimentaire d'ici 2050. Aujourd'hui, les EAU exploitent des terres dans de nombreux pays africains, en Asie et en Amérique latine.
Cas emblématique : la société émiratie Al Dahra se targue d'être le premier producteur de blé… en Égypte. Les Émirats sont aussi très actifs au Soudan, riche en or et terres agricoles. En 2018, après la chute d'Omar el-Béchir, des comités populaires ont réclamé le contrôle des terres, mais ils ont été débordés par les forces armées. En 2022, les EAU ont signé un accord pour exploiter 160 000 ha au Nord, reliés à un projet de port pharaonique, annulé à cause de la guerre civile. Cela aurait un peu plus renforcé le réseau portuaire émirati : Dubai Ports World est l'un des plus grands opérateurs mondiaux (carte), et connecte déjà près d'un million d'ha de terres arables à travers la planète.
Mais il existe un autre modèle d'accaparement, moins connu : le marché des crédits carbone. En Afrique, les Émirats convoitent des forêts immenses et une multitude de crédits, obtenus grâce à la plantation ou la préservation d'espaces boisés. Un mécanisme de compensation prévu par les accords de Paris l'autorise, et instaure un vrai marché entre pays à émissions de CO2 réduites et pays excédentaires.
La société Blue Carbone (fondée par un membre de la famille royale de Dubaï) a signé en 2023 des mémorandums de gestion sur un total de 25 millions d'ha de forêt (presque la moitié de la France métropolitaine). Cela concerne : 10 % de la surface du Libéria, de la Tanzanie, de la Zambie, et 20 % du Zimbabwe. Les baux vont jusqu'à 30 ans.
Ce marché est déjà subi de plein fouet par les populations amazoniennes. Le géant pétrolier Chevron a, par exemple, obtenu 3 millions de crédits, issus de projets REDD+ (préservation de l'environnement) en Amazonie colombienne. Mais les communautés locales disent ne pas avoir été prévenues...
Le bureau de Défense du peuple alertait sur le danger que les peuples indigènes soient chassés par des groupes armés illégaux, qui gèreraient les forêts à leur place, trouvant, dans ce marché, un juteux négoce.
La main basse sur les terres n'est pas le monopole des États du Golfe, ni même de la Chine ou de la Russie (voir LSDJ n°2558). Les États-Unis et d'autres pays sont également visés par les ONG. L'Ukraine est au centre des convoitises. L'accaparement profite d'un angle mort du droit, souvent pour des causes a priori légitimes (répondre à des besoins alimentaires). Mais la fin justifie-t-elle les moyens ? D'autant que, dans des sociétés de consommation, il faudrait déjà distinguer demande et nécessité.
- Les Émirats Arabes Unis détiennent un réseau portuaire connectant près d'un million d'ha de terres arables à travers la planète.
- Les sociétés militaires privées jouent un rôle clé pour sécuriser les enclaves. L'américain Eric Prince est à la tête d'un empire fournissant des services de mercenariat.
- Le marché des crédits carbone est un autre modèle d'accaparement. La société émiratie Blue Carbon, souhaite obtenir les droits de gestion sur 25 millions d'ha de forêt en Afrique.
- Les États se mettent d'accord, souvent au préjudice des petits agriculteurs et des populations locales.