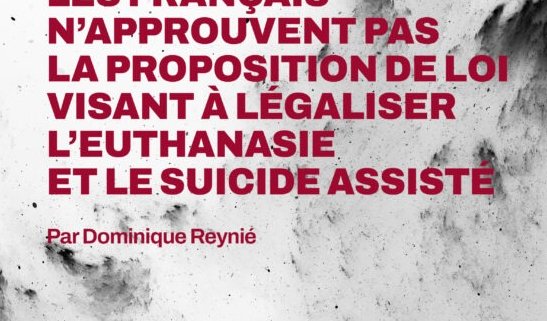Le Conseil d'État tranche en faveur de la cause animale
Jusqu'en 2016, le Code de l'environnement utilisait encore le terme de « nuisibles ». Ce dernier posait un double problème, à la fois légal, car une espèce ne peut être jugée nuisible en soi, et éthique, puisqu'aucun être vivant n'est néfaste par nature. Sous la pression de juristes et d'associations, l'administration a donc abandonné ce terme et a opéré un virage, à la fois lexical et juridique, en introduisant la notion d'ESOD. Ce nouveau cadre repose sur une classification de certaines espèces en trois groupes. Un premier de six espèces, répertoriées comme espèces envahissantes sur tout le territoire, par arrêté ministériel, dont le ragondin, le raton laveur ou le rat musqué. Un groupe concernant trois espèces, classées ESOD par arrêté préfectoral annuel, le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier. C'est sur le 2ème groupe que porte la décision du Conseil d'État. La martre en a été totalement retirée, tandis que le renard, la fouine, la belette ou l'étourneau en ont été exclus localement (liste non exhaustive). Cette décision intervient alors que les préfectures s'apprêtent à préparer leurs propositions de classement pour la période 2026–2029. Elles devront en tenir compte.
Les ESOD ne couvrent donc qu'une partie des espèces chassables, mais permettent des tirs et piégeages en dehors des périodes de chasse. Lors d'une consultation publique, le projet avait été massivement rejeté par les citoyens.
Le Conseil d'État a estimé que l'administration n'avait pas démontré, en effet de manière suffisante, que ces espèces représentaient un danger réel et constant pour les cultures, les élevages ou les biens. Une décision saluée par les associations de protection de la nature, critiquée par les chasseurs et syndicats agricoles, qui dénoncent une justice aux ordres « des animalistes » et un abandon des réalités rurales.
Beaucoup ont réagi en appelant à multiplier les déclarations de sinistres, alors même que certains critiquent ce système basé sur l'auto-évaluation des dégradations et de leurs coûts. Pour Chasse Passion, « le manque de données amène à de telles situations et offre la victoire aux associations anti-chasse ». Dans une vidéo, un intervenant de « Passion Piégeage » appelle à signaler l'ensemble des dégâts, afin de permettre le reclassement des espèces concernées.
Un rapport publié en 2024 par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité remet largement en question la solidité du concept, estimant qu'il ne repose sur aucun fondement factuel. Il pointe des critères de dégâts jugés subjectifs et instrumentalisés, l'absence d'évaluation des effets positifs des espèces, ainsi que la négligence des alternatives à l'abattage. Sur le plan sanitaire, ces espèces sont aujourd'hui largement réhabilitées par les faits. Les risques invoqués paraissent infondés, voire inexistants. Sur ce point, les positions semblent se rapprocher.
Ce sont les notions mêmes de « régulation » et de « nuisance », ainsi que l'efficacité des mesures qui cristallisent l'ensemble des tensions. Chaque camp revendique une légitimité, les représentants chasseurs mettent en avant leur rôle historique et l'impact socio-économique de la chasse, se présentant comme les premiers écologistes. En face, les associations défendent une approche centrée sur la préservation du vivant et condamnent des pratiques dites « barbares ». Selon un sondage de 2025, 70% des Français sont favorables à l'interdiction du déterrage, quelle que soit l'espèce.
Cette classification a été portée par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, dont le nom suggère un équilibre… que sa composition dément. Sur les vingt-neuf membres de l'instance, vingt sont directement issus ou liés au monde de la chasse et à ses alliés traditionnels, notamment agricoles et forestiers. À l'inverse, la représentation scientifique et environnementale se limite à quatre sièges. À cela s'ajoutent cinq représentants de l'État.
Un rapport de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable remet en cause le dispositif. Contrairement aux autres pays étudiés, la France applique une logique unique, à savoir celle d'une éradication des espèces listées. Le rapport recommande de ne pas renouveler l'arrêté en 2026 et plaide pour une gestion au cas par cas, fondée sur la réalité du terrain, axée sur la prévention, la cohabitation, la stérilisation ou la vaccination. La mise à mort ne devant intervenir qu'en dernier recours. Pour mesurer l'enjeu, cela représente chaque année près de 500 000 renards tués, 1,5 million d'oiseaux sauvages et environ 50 000 fouines, martres et belettes éliminées.
Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), s'est exprimé sur ce rapport lors de son congrès en mars 2025. Il a dénoncé ses auteurs comme étant issus d'une « technostructure européenne ou nationale qui pense et décide pour nous ». Il oppose à cette approche institutionnelle une vision de terrain et fait un résumé ironique : « Je vous fais le pitch en plus simple : plus de piégeage ou de déterrage, seulement des actions ponctuelles en cas de dégâts économiques. Et des animaux qu'il ne faudrait plus tuer, mais déplacer après leur capture, pour qu'ils soient ensuite relâchés, avec précaution, dans un endroit où ils ne feront plus de dégâts... ». Cette critique révèle une opposition de fond puisque le rapport défend un changement de paradigme profond, là où la FNC met en avant une continuité ancrée dans les usages et les traditions. Deux visions du rapport à la nature qui peinent à se rencontrer.