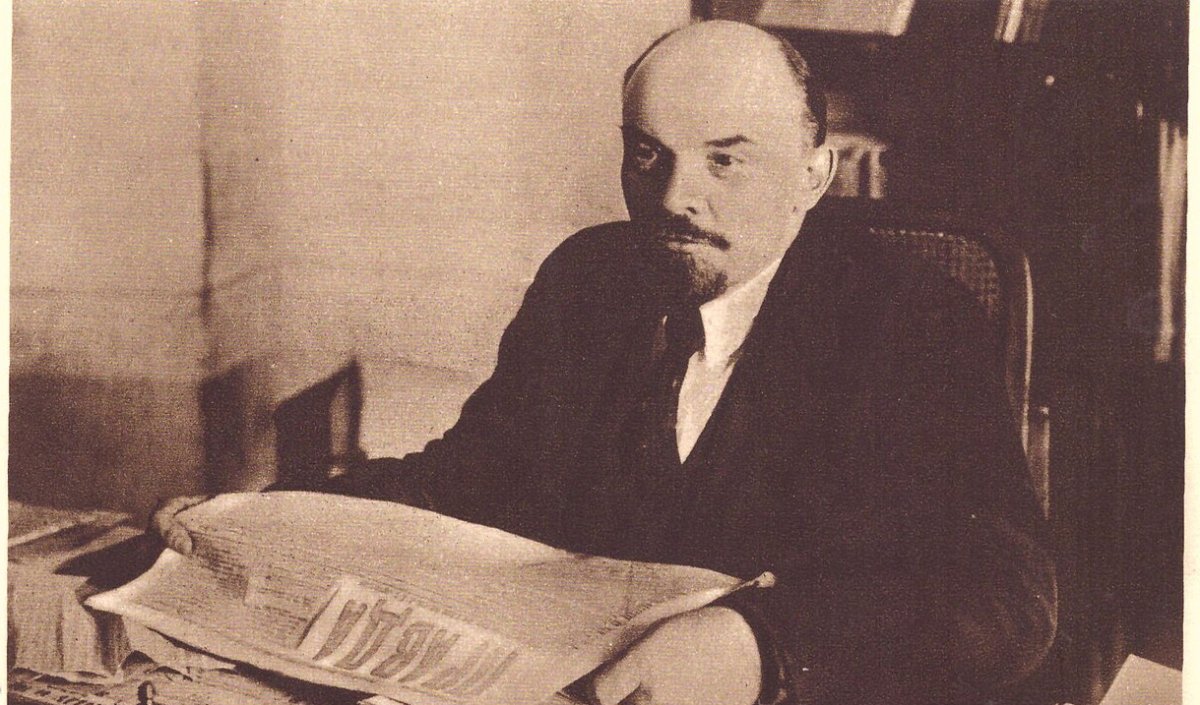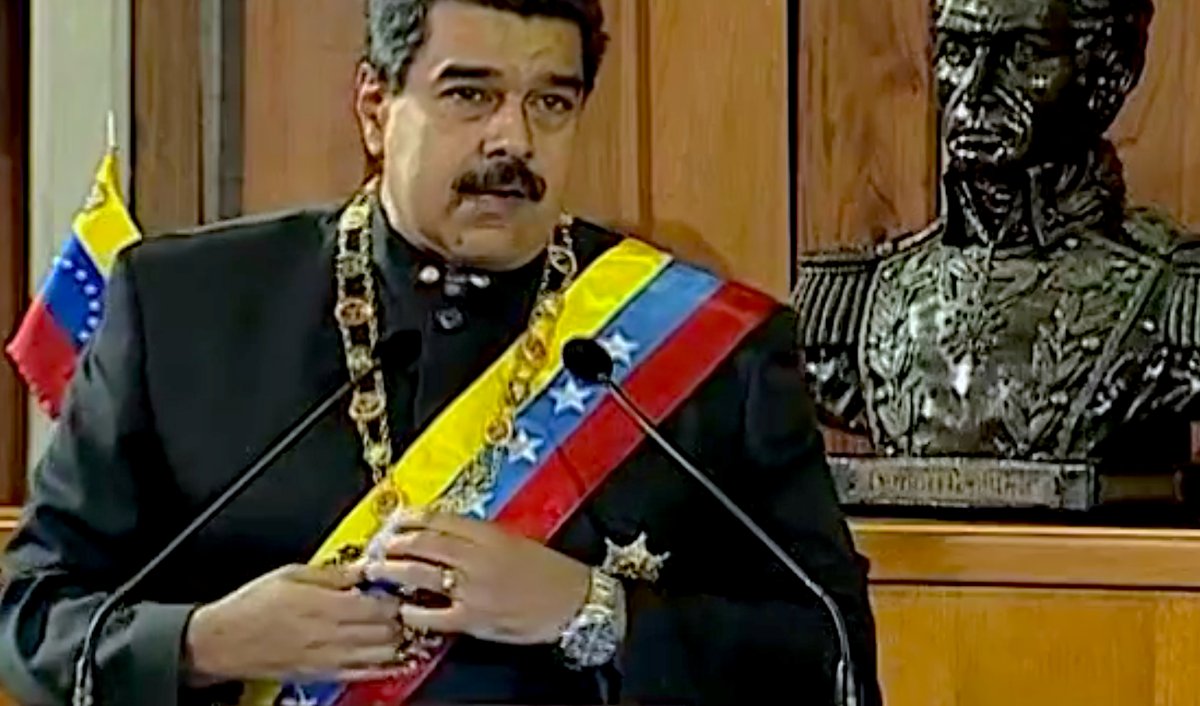Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, deux âmes d'élite amies des pauvres
Sportif, farceur et bruyant, Pier Giorgio Frassati (La Croix) grimpe haut et descend bas, des montagnes piémontaises aux taudis de Turin. Un cœur de feu, une joie communicative, même s'il chante si faux qu'on l'appelle « Fracassati ». Tout doit rouler pour lui, selon la théorie de la reproduction sociale. Maman peintre, papa sénateur, diplomate, un temps ambassadeur à Berlin, et fondateur de La Stampa, journal à la reprise duquel il destine son fils, même s'il ne lui en parlera jamais en face. Frassati junior déçoit les attentes de ses parents, fait des fautes d'orthographe, peine à l'école. La pression de son milieu l'oblige à réussir, lui interdit aussi d'épouser la fille dont il est amoureux. Il y renonce pour sauver le mariage de ses parents qui ne s'entendent pas. La mondanité aurait dû emporter cette âme pour la noyer dans la vanité et les honneurs.
Mais c'est plus fort que lui : « Aller vers les pauvres, c'est aller vers Jésus », écrit-il (Collège des Bernardins). Ses études d'ingénieur ne le subliment pas ; il se rêve missionnaire. Dès l'âge de 17 ans, il rejoint les Conférences de saint Vincent de Paul. Sa compassion naturelle devient surnaturelle. Car très jeune, il se montre plein d'attention pour les autres. Un jour, il croise un enfant sans chaussures. Pier Giorgio lui donne les siennes et rentre chez lui pieds nus, disant à sa mère qu'il a rencontré un enfant qui en avait plus besoin que lui... Souvent, cet alpiniste reviendra à la maison à pied après avoir donné son ticket de tram, ou avec un manteau râpé après s'être délesté du sien, comme saint Martin. Si ses parents sont riches, il n'a que de l'argent de poche. Il garde des enfants, vend timbres et billets de tramway, fait la quête de porte en porte. Il offre une machine à coudre à une couturière, veuve avec enfants, qui n'en avait plus. Pier Giorgio passe plusieurs soirées par semaine auprès des pauvres, parfois jusque tard dans la nuit, y compris dans les logis où on le dissuade d'aller. Selon Luciana Frassati, sa sœur et son biographe (morte à 105 ans en 2007 !), il suit une quinzaine de familles pauvres de Turin, leur apporte de la nourriture, des vêtements et des médicaments. Si discrètement qu'à sa mort, la surprise est totale : mais qui sont ces indigents affluant autour de son cercueil, se dit la haute société piémontaise ? On retrouvera dans ses papiers des listes de pauvres et des annotations sur ce qu'il leur devait ou leur avait promis.
Comme Frassati, Carlo Acutis fait le bien en cachette. Comme lui, le « geek de Dieu » ne dévoilera l'étendue de sa compassion qu'après sa mort. Acutis utilise son argent de poche pour acheter des sacs de couchage, des couvertures, des repas qu'il distribue aux sans-abri de Milan. Il s'arrête pour discuter avec les personnes de la rue, qu'il connaît par leur prénom. Il ne donne pas seulement ; il se donne. Son bénévolat va des paroisses aux soupes populaires. Comme Frassati, il offre de petits sacrifices quotidiens pour que les pauvres profitent de ce dont il se prive.
Ces deux vies postulent qu'aider les pauvres n'est pas une option morale ou un geste superficiel, mais la mise en œuvre d'un commandement. C'est bien parce que Frassati et Acutis l'avaient intériorisé au plus haut point que leur rayonnement fut énorme. Rien n'est plus puissant qu'une injonction à la fois intérieure et supérieure ; rien n'est plus efficace que de se savoir responsable des autres et comptable de ses actes devant une autorité ultime, Dieu. La charité, dans l'acception chrétienne, se distingue de la solidarité anonyme et coercitive, par l'amitié (la relation) et la disponibilité (le temps) qu'elle requiert. L'État est censé n'intervenir qu'en dernière instance pour accompagner ou compléter l'action de chacun. Seuls les plus déshérités doivent pouvoir compter sur lui. Cet esprit fait dépendre la question sociale de la responsabilité individuelle. Vue ainsi, la chose paraît fragile car facultative. Que faire si les personnes favorisées négligent leurs devoirs, ne s'estimant plus redevables de ce que l'éducation et la religion leur commandent ? Les pauvres n'auront alors d'autre choix que de s'abandonner aux idéologies collectivistes et liberticides, à tout le moins à l'État et à ses transferts sociaux.