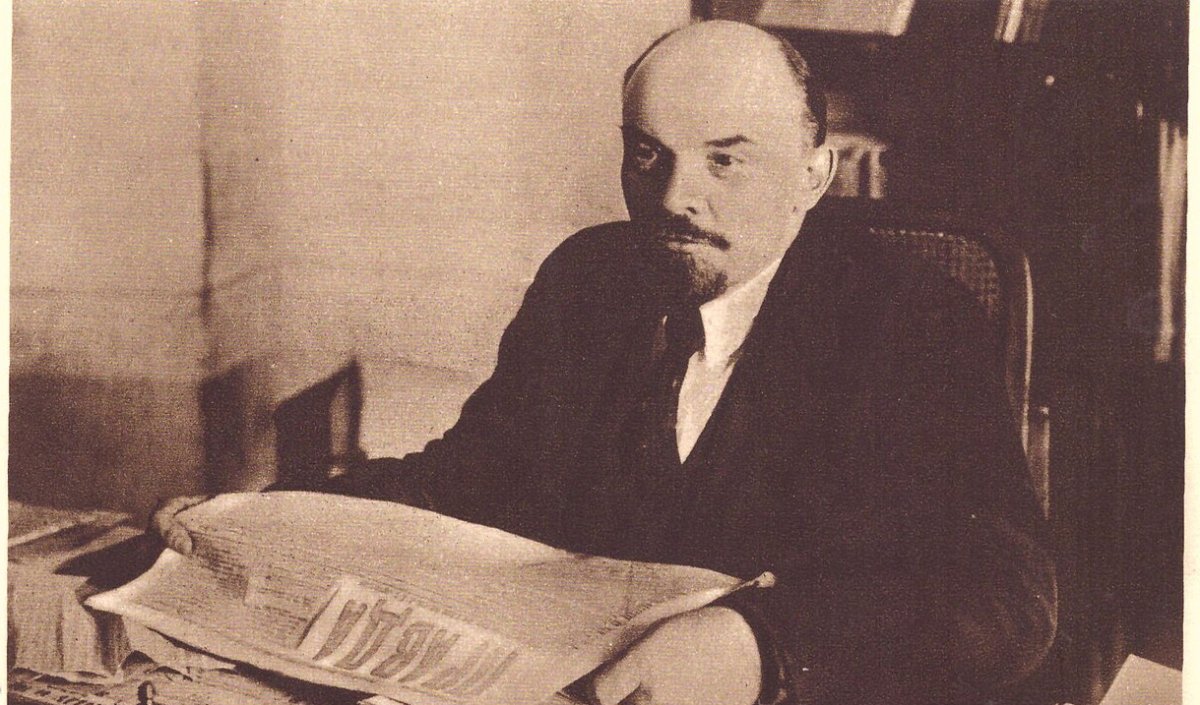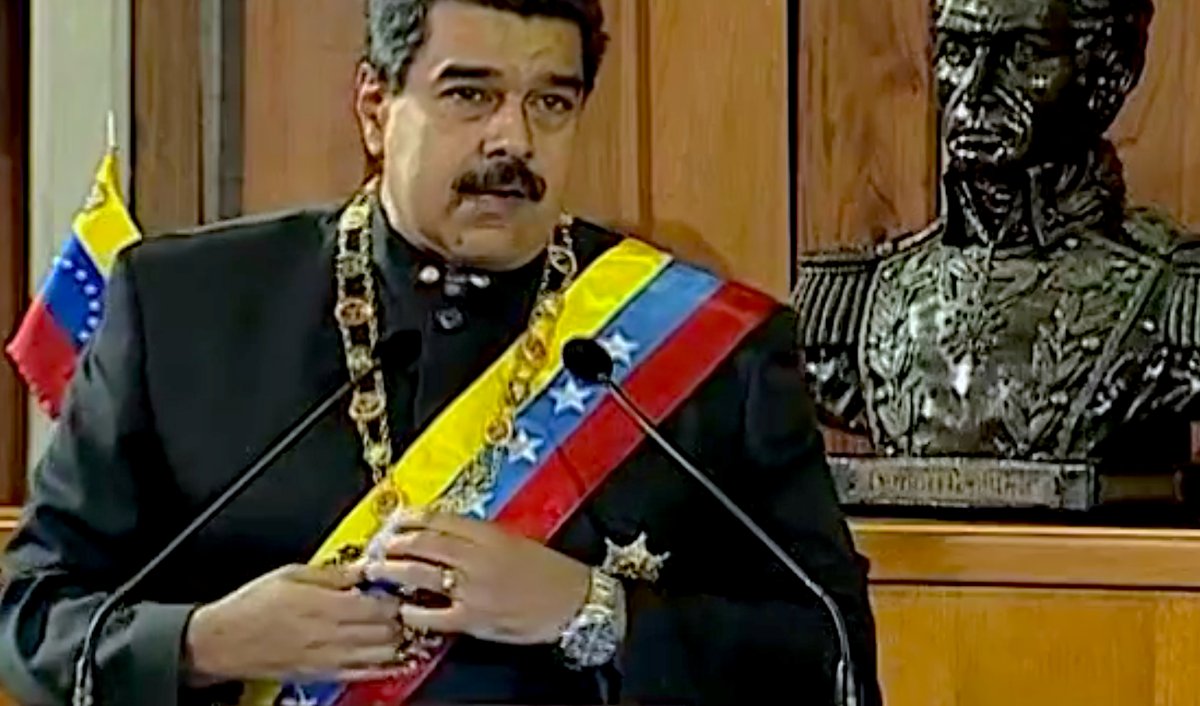Mangeurs de pain et mangeurs de riz : la grande fracture civilisationnelle
Le blé et le riz sont les céréales (de « Cérès », la déesse latine des moissons) à la base de notre nutrition. Elles sont cultivées dans des régions bien distinctes : le riz a besoin d'avoir les pieds dans l'eau et un climat chaud, quand le blé demande un environnement tempéré, des saisons découpées et des sols drainés. Une inondation est une calamité pour le blé, qui pourrit, alors qu'elle triple le rendement d'une rizière... Autre différence capitale pour l'humanité : le riz génère deux fois plus de calories sur une surface équivalente. Les conséquences sont structurantes pour les civilisations : une communauté cultivant le riz a besoin pour se nourrir de deux fois moins d'espace qu'une société consommant du blé... D'où une densité de population pouvant être beaucoup plus élevée, et moins d'incitation à agrandir son territoire. Mais s'occuper d'une rizière demande beaucoup de travail toute l'année, de la préparation des parcelles, les semis, le repiquage, l'irrigation jusqu'à la récolte ! Et il n'y a pas de flexibilité : chaque tâche doit être effectuée pendant des périodes très précises, sous peine de perdre toute la récolte. La conséquence sociétale : les communautés rizicoles (principalement asiatiques) sont très coopératives, car les villageois ont l'obligation de s'entraider pour le repiquage et la récolte. Les communautés cultivant le blé (occidentales, par exemple) ne sont soumises à cette pression que pendant la moisson, une fois dans l'année.
Une divergence politique
La culture de blé ne requiert pas d'infrastructure lourde et partagée pour l'irrigation. Il en résulte une plus grande indépendance des familles de fermiers en Occident. D'où le développement de régimes décentralisés – comme la féodalité au Moyen Âge. À l'inverse, la Chine a fait face à des besoins de coordination cruciaux pour gérer l'irrigation et synchroniser le repiquage, sans compter les travaux de terrassement. Quand la maîtrise de l'eau est centrale pour la survie d'une population, l'émergence d'un État fort est favorisée.
Une divergence culturelle
La terre cultivée, le champ de blé ou la rizière en terrasse, imprime une marque profonde sur les paysages et la population concernée. Il n'est donc pas étonnant que les Occidentaux soient décrits comme plus individualistes que les Asiatiques... Une étude sociologique s'est concentrée sur la Chine, où les deux céréales sont cultivées (le blé au nord du pays). Des différences notables ont été rapportées par le biais de tests psychologiques. Les « gens du riz » se mettent moins en avant, car ils dépendent les uns des autres et suivent des normes sociales plus strictes que les « gens du blé ». L'ordre est plus facile à contrôler chez les « gens du riz », mais ces derniers sont plus susceptibles de se soumettre à un régime autoritaire, et sont plus hermétiques aux arrivées et influences étrangères. Une observation similaire a été faite par des sociologues au Japon, comparant les gens des côtes, vivant de la pêche, et les riziculteurs de l'intérieur des îles. Le collectivisme est plus naturel, plus facile à imposer dans une communauté cultivant le riz...
Une divergence économique
La saisonnalité du blé confère un grand avantage aux fermiers, laissant de l'espace pour développer un artisanat, du commerce. Le fait que la Révolution industrielle soit née en Europe occidentale n'est sans doute pas fortuit, alors que les terres disponibles étaient toutes cultivées. On observe par ailleurs que le « Nouveau Monde » américain offrait au contraire des terres immenses aux colons européens, sans avoir besoin d'infrastructures lourdes au départ. Des terres semblant illimitées, une main-d'œuvre rare : on comprend aussi pourquoi les États-Unis sont devenus les champions de l'automatisation, pour résoudre ce paradigme. Situation tout à fait inverse en Asie rizicole : les terres disponibles étaient déjà exploitées, et une grande masse de travailleurs était nécessaire. Automatiser la riziculture ? Très difficile, car les outils doivent fonctionner dans la boue et l'eau, sur des parcelles réduites limitées par des digues. Ceci explique pourquoi la première puissance asiatique, la Chine, n'a pas cherché à coloniser d'autres espaces et n'était pas au rendez-vous de la Révolution industrielle, alors qu'elle ne manquait ni de savants ni d'expérience dans l'innovation...
Même si les sociétés modernes d'aujourd'hui dépendent moins de la terre cultivée qu'autrefois (toujours pour se nourrir, mais pas en termes sociologiques après les exodes ruraux), la consommation de pain ou de riz reste un marqueur civilisationnel profond dans le subconscient collectif.