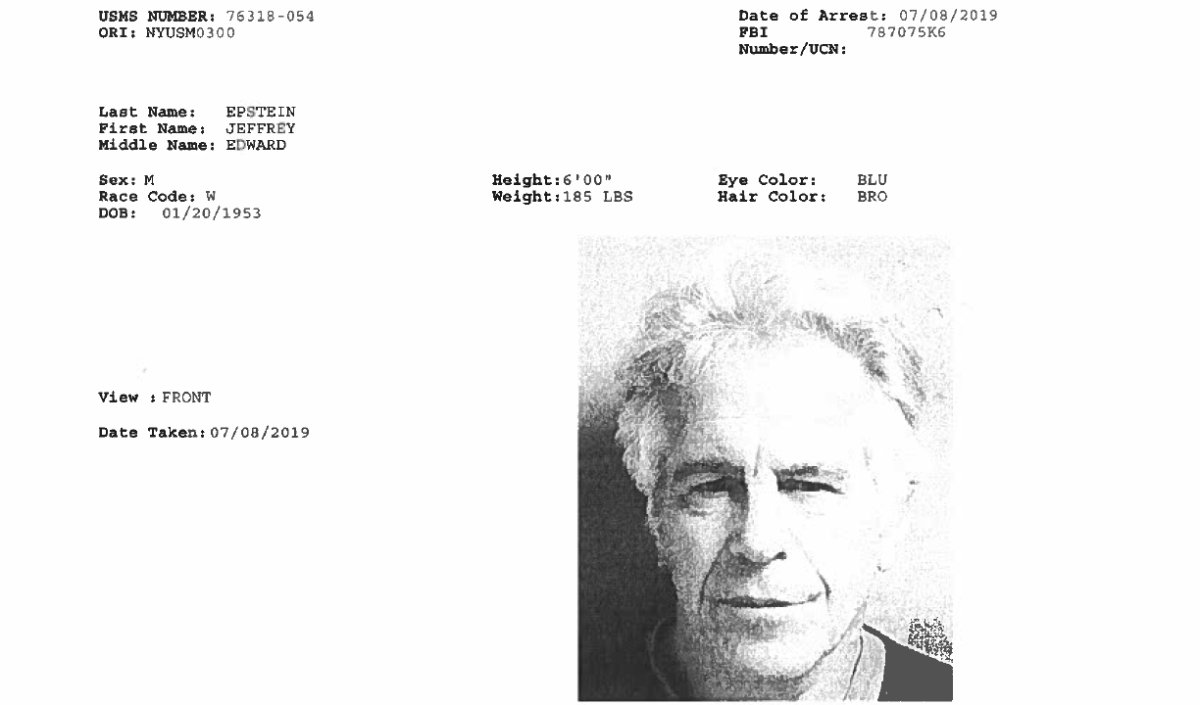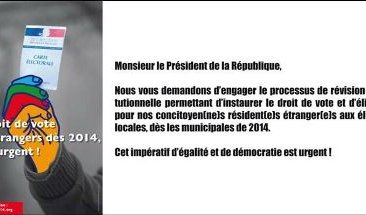Maladie de Lyme, le fléau silencieux
Avec la maladie de Lyme, il y a la courte liste de ce que l'on sait, et la longue liste de ce que l'on ne sait pas.
Parmi les certitudes : c'est une maladie vectorielle, c'est-à-dire qu'elle est infectieuse et transmise par un vecteur, souvent un insecte, en l'occurrence les tiques. La bactérie responsable s'appelle Borrelia burgdorferi. Les symptômes sont nombreux (fièvre, maux de tête, douleurs articulaires), mais le plus caractéristique est ce halo rouge autour de la morsure appelé érythème migrant (de nombreuses photos dans ce document). Si l'érythème est là, pas de doute, la personne est infectée. Mais s'il n'est pas là, pas de certitude sur l'absence d'infection : 50 % des personnes ayant Lyme n'ont pas le souvenir d'un érythème migrant. Mais pire : comme la morsure de tique est totalement indolore, 70 % des malades n'ont pas le souvenir d'avoir été en contact avec la bestiole.
La tique est un insecte aussi redoutable que discret. Si la taille d'un adulte est de près d'un centimètre, la tique peut mordre au stade de nymphe, qui s'avère la plus dangereuse. La nymphe – plus grande que la larve – mesure un ou deux millimètres, elle est capable de transmettre toutes les bactéries, mais très difficile à localiser, car elle ressemble à s'y méprendre à un tout petit grain de beauté. Quand la nymphe mord en toute discrétion, elle peut ensuite rester nichée dans un endroit caché, comme le cuir chevelu, derrière les oreilles, dans le nombril ou le pli interfessier avant de tomber deux ou trois jours après. Elle s'est gavée de sang et elle a transmis ses bactéries sans aucun bruit. Pas vu, pas pris.
On pourrait naïvement penser que – grâce aux tests – il est facile d'identifier la maladie présente dans l'organisme. Là encore, désillusion. La bactérie Borrelia est difficile à localiser : elle se cache, esquive, change d'endroit. Faire un test juste après une morsure ? Inutile, explique le Professeur Perronne dans ses nombreuses interviews comme ici. En effet, explique-t-on très bien dans cet article de Science et Avenir, il s'agit d'un dépistage indirect pertinent à partir de 6 à 8 semaines après la morsure : « On ne va pas chercher à détecter la bactérie chez le patient, mais plutôt les anticorps produits par son système immunitaire et dirigés spécifiquement contre les antigènes de la bactérie ». Mais les réponses immunitaires sont très variables d'une personne à l'autre selon qu'elle prend des médicaments, souffre d'une autre pathologie, etc. On estime que, pour Lyme, il y a un risque 500 fois plus élevé d'avoir un « faux négatif » que pour le VIH.
Parmi les tests utilisés, on entend souvent parler du test Elisa en première intention, et du Western Blot ensuite. Les spécialistes sont formels : si un test Elisa est positif, il est positif ; mais s'il est négatif, cela ne veut rien dire. Quant au Western Blot en deuxième intention, là encore, pas de certitude. Comme on peut le lire sur le site de l'Association France Lyme, tous ne se valent pas : « Pour une sérologie pour la borréliose de Lyme, demandez au médecin généraliste une ordonnance : « Analyse de sang, sérologie de Lyme avec Elisa et Western Blot (WB) ALL DIAG de MIKROGEN ». Il y a une différence majeure entre le Western Blot commun et de marque commerciale MIKROGEN. Le WB commun est basé sur une souche de borrélia américaine, alors que le WB de marque commerciale MIKROGEN est basé sur plusieurs souches de borrélia européennes, donc mieux adapté en Europe. » Pour les animaux – eux aussi exposés à la maladie de Lyme – les vétérinaires utilisent des tests PCR qui seraient plus fiables. On en arrive à des situations inédites, comme cette femme qui explique à Paris Match avoir fait passer son analyse de sang pour celle de son chien afin de pouvoir bénéficier d'un test PCR.
Un mot sur le Pr Christian Perronne : auteur d'ouvrages sur le sujet, il reste le grand spécialiste de la maladie de Lyme. Il est démis en 2020 de son titre de chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU Raymond Poincaré, pour avoir « tenu des propos considérés comme indignes de la fonction qu'il exerce ». Il avait remis en question la politique gouvernementale en matière de Covid.
Enfin, reste le cœur du débat qui fait rage depuis des décennies en France : la maladie de Lyme est-elle une maladie chronique ?
À l'heure actuelle, elle n'est pas reconnue comme telle, au grand dam des milliers de malades qui souffrent de multiples symptômes : fatigue, douleurs chroniques, troubles de la mémoire et de la concentration, voire – dans les formes les plus graves – paralysie faciale, encéphalite, névralgie… D'un côté, il y a les patients, défendus par les associations, affirmant que c'est une maladie chronique et qu'il faut considérer comme telle. Pour d'autres, ces symptômes ne sont pas caractéristiques et pourraient révéler tout autant une polyarthrite rhumatoïde ou une fibromyalgie. En février 2025, la Haute Autorité de santé a actualisé ses recommandations, espérant peut-être réconcilier les parties, mais semant un peu plus le trouble. En effet, dans le texte, on n'y parle toujours pas de maladie chronique, mais on reconnaît l'existence d'un « syndrome post-borréliose de Lyme traitée » ou « PTLDS » (post-treatment Lyme disease syndrome en anglais). Cherchez la différence.