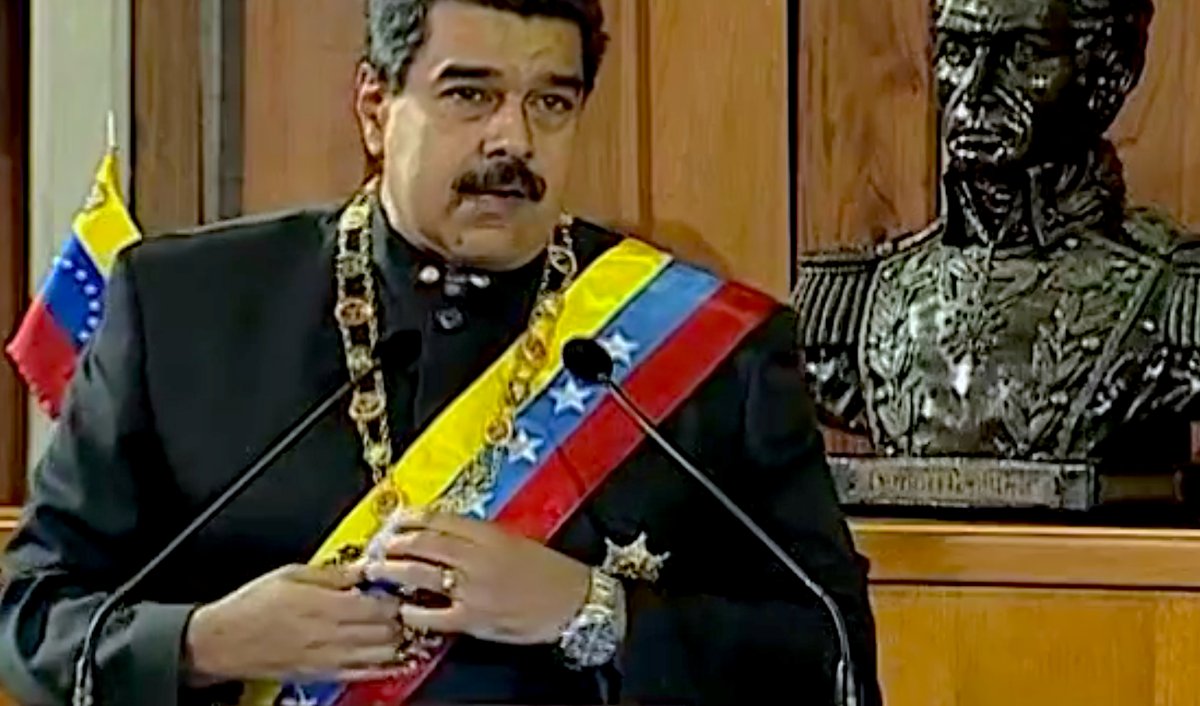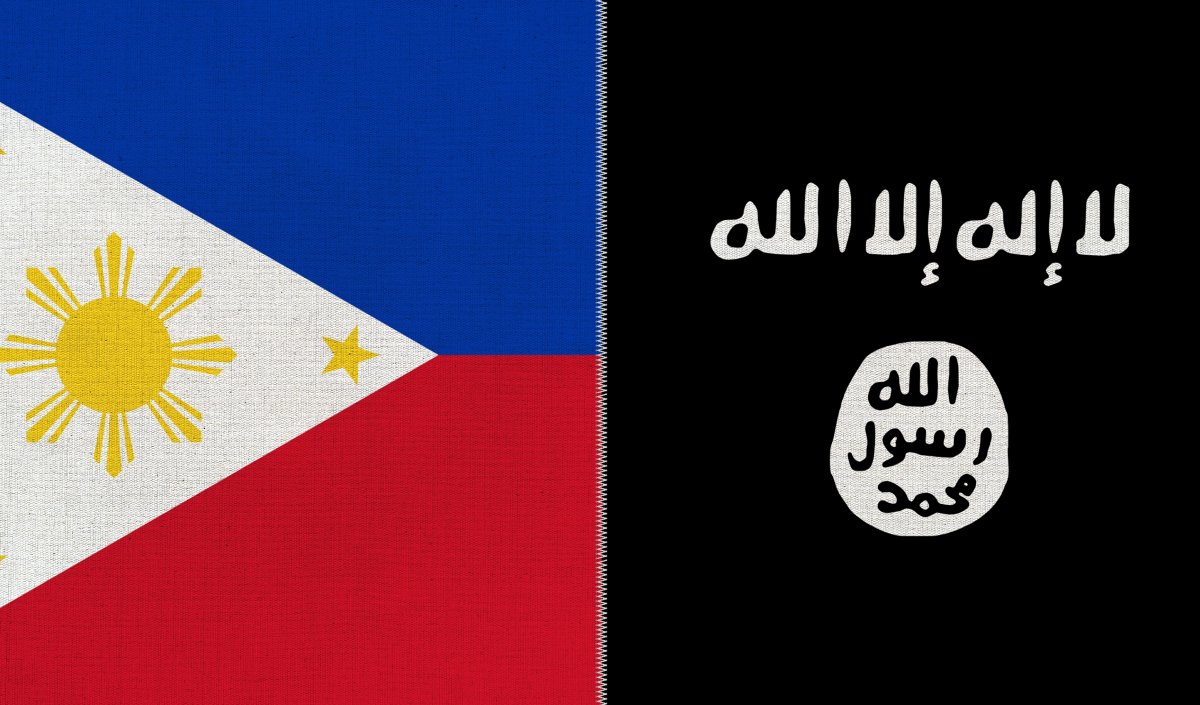Léon XIV, pape du sud épris de paix
La première impression est souvent la bonne. En 2005, à la loggia, Benoît XVI paraissait porter le poids de sa charge, comme si sa renonciation à venir l'habitait déjà secrètement. En 2013, le pape François, sans parure et tout en blanc, dialoguait directement avec la foule. Douze ans plus tard, Léon XIV, l'œil humide et la gorge nouée, dessine sur son visage un long sourire doux et profond. À ce moment-là, il émut le monde et rassura l'Église. Vêtu de la pélerine rouge et de l'étole, son attitude réinstallait la papauté dans ses usages et ses apparences. Léon XIV devrait habiter l'appartement pontifical du Palais apostolique – rouvert dimanche, mais qui doit être rénové – et que le pape François avait déserté. Éprouvée par une gouvernance bergoglienne brutale et solitaire, la Curie romaine retrouve ses marques. Paisiblement. Léon XIV écrit ce qu'il dit, se tient à l'écart des mises en scène et de l'improvisation, même s'il sait signer des autographes avec humour (TF1, à 1mn 55 sec).
« Que la paix soit avec vous tous ! » sont les premières paroles du pape américain. Ce mot « paix », le nouveau pontife le fait sien à plus d'un titre. Il pense d'abord à la paix des âmes, lorsque, au cours de sa première bénédiction, jeudi, il plaide pour une paix « désarmée et désarmante », celle du « Christ ressuscité ». Puis à la paix des armes quand, dimanche, il y exhorte « les grands de ce monde » et dit sa solidarité avec « les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé ». Le lendemain, Volodymyr Zelenski annonce s'être entretenu avec lui et l'avoir invité en Ukraine. Léon XIV profère deux slogans : « Le mal ne prévaudra pas » et « plus jamais la guerre ».
Il parle aussi de la paix des esprits lorsque, vendredi, au cours de sa première messe, il déplore « le manque de foi [qui] entraîne souvent des drames », comme « la violation de la dignité de la personne » ou « la crise de la famille ». Il aborde la paix des intelligences quand, vendredi et samedi, il s'afflige du recul de la foi chrétienne et « des contextes où on lui préfère d'autres certitudes » comme « la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir ». Si le mot « technologie » arrive en premier, c'est que le défi de l'IA exige « responsabilité et discernement ». Le nouveau pape évoque enfin la paix de la parole lorsque, devant les journalistes, il juge qu' « une communication bruyante, musclée, n'est pas nécessaire » et qu'il plaide pour « une communication capable d'écoute » et « de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix ».
Les « faibles » justement. Le mot rappelle Léon XIII (1878-1903) dont l'encyclique Rerum novarum (« la soif d'innovations », 1891) affronte la deuxième révolution industrielle. Le « pape des ouvriers » y condamne le socialisme athée et le capitalisme débridé. « Il ne peut y avoir de capital sans travail ni de travail sans capital », écrit le pontife du XIXe siècle. La référence à ce pape (Zenit) donne à penser que Léon XIV placera la justice au cœur de son action. Après François et la prise de conscience écologique, il pourrait s'attaquer à la révolution techno-scientifique et au système économique sans frein qui en favorise les aspects déshumanisants. Sa réponse commande de dépoussiérer la Doctrine sociale de l'Église (DSE), de faire advenir dans le champ politique des concepts comme le « bien commun », la « dignité » et la « destination universelle des biens ». Ce discours devra passer aux États-Unis, premier pays contributeur au Denier de Saint-Pierre (Vatican News) et dont une bonne part des 70 millions de fidèles refusait le discours bergoglien sur la « dictature de l'économie sans visage » et de « la tyrannie invisible, mais réelle » des marchés financiers (Evangelii Gaudium, 2013). Pour certains, le pape François était même « communiste » (La Croix) ! Rerum Novarum n'est pas inconnu des Américains. Cette encyclique destinée à contrer le marxisme permit au syndicalisme d'émerger aux États-Unis, notamment à Chicago, ville du « premier 1er mai » (1886). La pensée sociale de l'Église a sans doute des choses à partager avec un J. D Vance post-libéral, possible successeur de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le vice-président américain dit avoir bien accueilli l'élection de Robert Francis Prevost, tout comme le chef de file de l'opposition conservatrice, le cardinal Raymond Leo Burke.
Né à Chicago en 1955, le nouveau pape trouvera cependant un catholicisme américain fort différent de celui de sa jeunesse (Le Monde), en particulier sur la question migratoire, où il « semble très éloigné de Donald Trump et de son nationalisme hostile aux immigrés » (Courrier international). Le sujet divise, y compris chez les conservateurs US. Dans son dernier retweet du 14 avril, il critiquait l'expulsion (« deportation » en anglais !) vers le Salvador, de Kilmar Abrego Garcia, clandestin et père de trois enfants : « Ne voyez-vous pas la souffrance ? Votre conscience n'est-elle pas troublée ? Comment pouvez-vous garder le silence ? » s'écriait-il. D'autres messages, plus anciens, vont dans le même sens (Daily Mail). Interviewé le 29 janvier dans l'émission Hannity sur Fox News, J.D Vance défendait le concept chrétien d'ordo amoris (Je cherche Dieu), selon lequel il faudrait prioriser l'amour envers ses concitoyens avant de se soucier des étrangers : « J.D. Vance a tort : Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres », répliqua le futur Léon XIV. Le cardinal Prevost pose un principe quand J. D Vance se veut pragmatique : il lui semble plus logique, naturel et facile d'aimer son prochain plutôt que son lointain. Sauf qu'aux yeux du pape, le monde et l'amour ne sont pas régis par la pénurie et la peur. Car un évêque « ne doit pas être un petit prince assis en son royaume [mais] doit être proche du peuple qu'il sert, et marcher avec lui, souffrir avec lui », déclarait le prélat américain en 2024 (RFI). Un pape peut-il dire autre chose ?
De même, sur les questions de mœurs, le cardinal Prevost se situe dans la ligne du pape François, hostile à la théorie du genre. Son prédécesseur l'assimilait à une « colonisation idéologique » (Genéthique) et jugeait « inacceptable » « l'endoctrinement » par les manuels scolaires (France Info). Selon Prevost, cette théorie « est source de confusion, car elle cherche à créer des genres qui n'existent pas » (New York Post). Sur la question homosexuelle, il pourrait se montrer moins accommodant que feu l'Argentin (The Gospel edition). En 2012, il exprime son inquiétude face à une culture occidentale favorisant « la sympathie pour des croyances et des pratiques contraires à l'Évangile », faisant directement référence « au mode de vie homosexuel » (L'Humanité). En 2015, il tweete une photo de la marche pour la vie à Chiclayo. Lors du Synode sur la synodalité (octobre 2023), il déclare que « cléricaliser les femmes » — c'est-à-dire les ordonner à des rôles cléricaux — ne résoudrait pas les problèmes de l'Église et pourrait même en créer de nouveaux » (National Catholic Register), alors qu'en juillet 2022 trois femmes (sœur Raffaella Petrini, Sœur Yvonne Reungoat et Maria Lia Zervino) devenaient membres du Dicastère pour les évêques. Une première. Enfin, sur les divorcés remariés, le cardinal Prevost soutient le changement entamé par François de leur permettre de recevoir la communion.
Léon XIV est-il « le moins américain des cardinaux américains », comme le dit La Repubblica ? D'un père franco-italien et d'une mère hispano-créole (Revue française de généalogie), Robert Francis Prevost est le premier pape né après la Seconde Guerre mondiale et le premier pontife possédant une double nationalité (américaine et péruvienne, acquise en 1995). Un homme formé au nord, mais donné au sud. Un pape des deux Amériques. Après deux pontifes européens, il achève la mondialisation commencée sous François, auquel il doit sa carrière fulgurante.
Juriste, canoniste, philosophe, licencié en mathématiques, polyglotte (6 langues), amateur de tennis, Robert Francis Prevost témoigne d'un triple parcours qui en fait une personnalité à la fois complète et équilibrée. Malgré sa discrétion, ce CV allait faire de lui un papabile élu en seulement quatre tours de scrutin. Le premier parcours est celui du missionnaire. « Father Bob » l'est au Pérou pendant vingt-deux ans, à raison de deux séjours (1985-1998 et 2014-2023) et huit ans passés comme évêque de Chiclayo (2015-2023). François le repère lors d'une visite andine en 2018. Son second parcours débute quelque temps après, lorsque le pape argentin le propulse à la tête du Dicastère pour les évêques (janvier 2023), poste clé dans les nominations à travers le monde, et qu'il le crée cardinal (septembre 2023). « DRH » de l'Église, Robert Francis Prevost voyage dans une cinquantaine de pays. Tous les cardinaux électeurs le connaissent. Cette ascension éclair, deux ans après son cardinalat, impressionnera le conclave. Son troisième parcours s'inscrit au sein de l'ordre des Augustins (OSA), congrégation fort active en Amérique latine. Robert Francis Prevost est facilement élu à deux reprises, comme supérieur provincial des Augustins du Midwest (1999) et comme prieur général (2001), soit à la direction mondiale de l'ordre. Cette confiance renouvelée ne passera point inaperçue. Mis bout à bout, tous ces éléments amènent à penser que Robert Francis Prevost, comme disent les journalistes, « cochait toutes les cases ». Puisse-t-il aussi en sortir afin que Léon XIV puisse éclore.