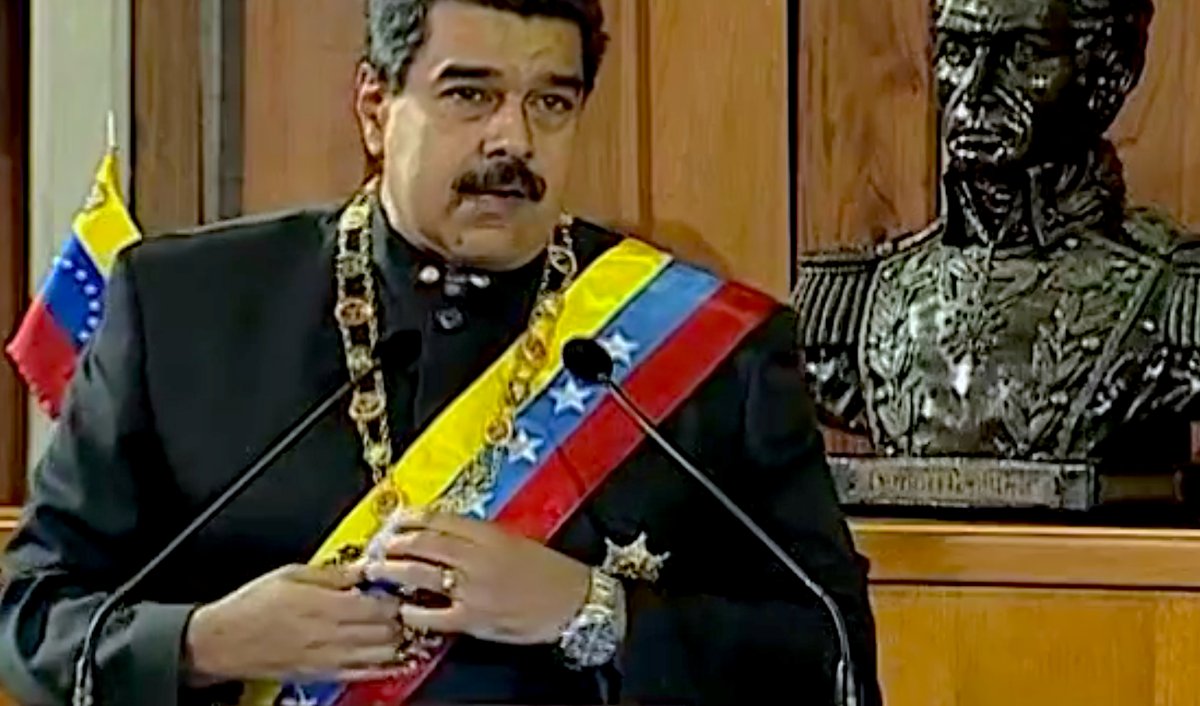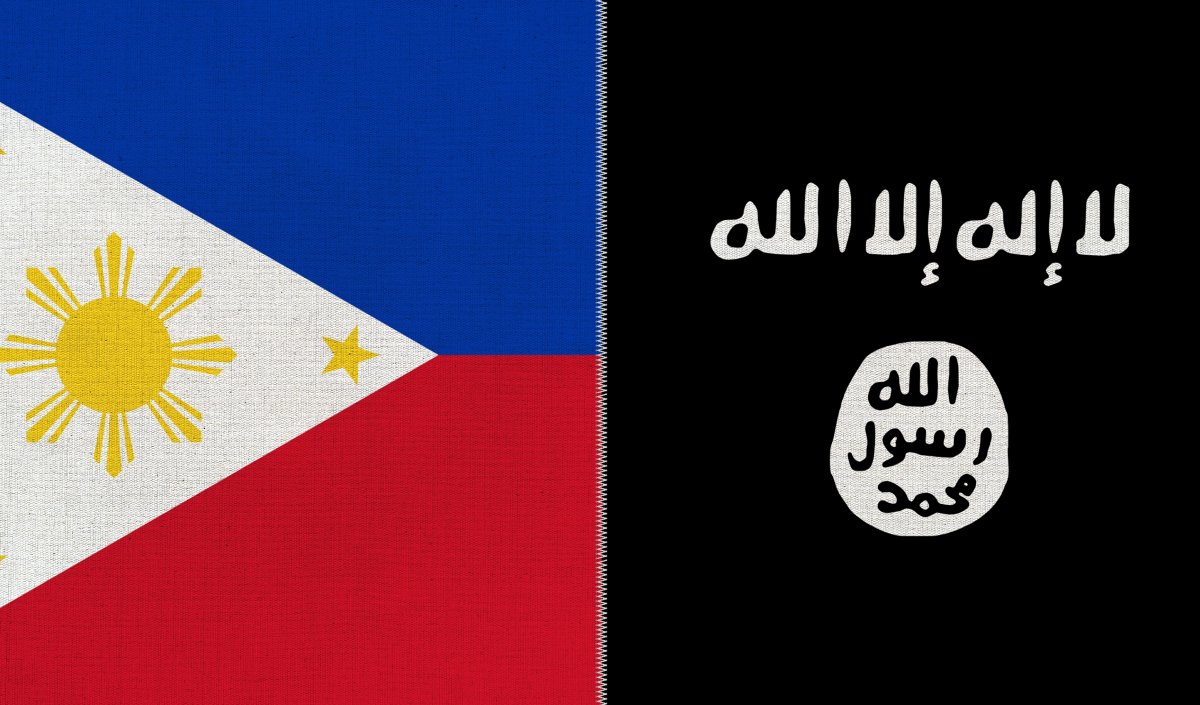Exploitation des travailleurs et pollution garantie, les dessous de la fast fashion
La fast-fashion, ou « mode express » en français, désigne un modèle de production et de consommation textile qui propose des vêtements tendance à bas prix, renouvelés très fréquemment. Des marques de fast-fashion, nous en connaissons tous : Zara, H&M, Primark... Implantées dans le quotidien des Français depuis les années 2 000, elles proposent en moyenne une vingtaine de collections par an. En comparaison, c'est 1 à 4 pour une marque « traditionnelle ». Mais depuis quelques années, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de l'ultra-fast-fashion. L'emblème de ce phénomène : le géant chinois Shein, qui domine le marché avec plus de 7 000 nouvelles références chaque jour, un record absolu. Et ce n'est pas sans conséquences.
L'industrie de la mode représente entre 4 % et 10 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En premier lieu, il y a la production du textile. Shein fait fort en la matière, puisque 75 % des vêtements sont en polyester, un plastique peu coûteux, fabriqué à partir de dérivés du pétrole. Si le polyester est très énergivore à produire, cette matière continue de polluer tout au long de sa (courte) vie. À chaque lavage, des milliers de microfibres plastiques finissent dans les océans et sont ingérées par les poissons avant de finir dans nos assiettes. Autre problème : en 2022, une analyse de l'ONG Greenpeace a révélé la présence, dans la production Shein, de nombreuses substances chimiques dangereuses, comme les phtalates, un perturbateur endocrinien reconnu, à des taux dépassant les lois européennes. Et si leur production et leur usage posent problème, leur fin de vie n'est pas moins préoccupante. La piètre qualité des vêtements les rend quasi jetables après utilisation et, bien sûr, ils ne sont presque jamais recyclés. Ils finissent alors leur course entassés dans des décharges à ciel ouvert, comme à Accra, au Ghana (voir photo d'illustration). Pour l'acheminement des commandes, expédiées depuis la Chine, elles sont systématiquement assurées par fret aérien et non maritime (contrairement à la majorité). Ainsi, les émissions de transport de Shein pour 2024 sont plus de 3 fois supérieures à celles du propriétaire de Zara, Inditex, pourtant pionnier de la fast-fashion.
Dans une enquête publiée en juillet dernier, deux ONG (ActionAid France et China Labor Watch) accusent le géant chinois d'une exploitation organisée. Trois enquêteurs se sont infiltrés en se faisant embaucher au sein des ateliers Shein. Ils dénoncent notamment des « cadences infernales » : les travailleurs seraient payés 0,06 à 0,27 centime d'euro la pièce. Leur rythme de travail dépasserait largement les seuils légaux chinois. Pour espérer obtenir un salaire « décent », certains travailleraient jusqu'à 16 heures par jour dans un environnement qui est décrit comme dangereux. D'après le rapport, « Les travailleurs et travailleuses interrogé(e)s [...] ont signalé l'absence d'équipements de protection individuelle, tels que des masques, dans des environnements où les microparticules synthétiques sont omniprésentes. Une telle exposition, répétée jour après jour, les expose à de graves problèmes de santé, d'autant plus qu'aucun suivi médical n'est assuré. »
Ces dénonciations n'ont pourtant pas freiné son succès en Europe. Elle serait même l'enseigne où les Français ont le plus dépensé en 2024, d'après une étude par l'application de shopping Joko. Même observation pour les autres plateformes chinoises du même modèle, comme Temu ou Aliexpress. Un marketing attrayant où promotions, collaborations avec des influenceurs et nouveaux articles en continu, à parfois moins de 1 euro, vous pousse à toujours plus consommer, sans culpabiliser. Une étude Ifop de février 2025, en partenariat avec Shein, révélait que le premier critère d'achat de vêtements neufs était leur prix pour 35 % des personnes sondées, loin devant l'esthétique (19 %) ou la qualité des matériaux (11 %). La baisse du pouvoir d'achat incite donc les Français à troquer les boutiques de prêt-à-porter, qui font face à une crise majeure depuis le Covid-19, pour l'ultra-fast-fashion chinoise. Une concurrence déloyale pour les entreprises françaises qui ne peuvent plus rivaliser. Avec des coûts de production bien inférieurs et l'absence de normes européennes, les colis provenant de Chine sont même majoritairement exemptés de droits de douane.
Le 10 juin dernier, le Sénat vote à l'unanimité une proposition de loi pour lutter contre la fast-fashion et l'ultra-fast-fashion. Elle prévoit notamment un système de bonus-malus : les entreprises concernées devront payer des « éco-contributions » d'au moins 5 euros par article, ainsi qu'une taxe sur les petits colis livrés par des entreprises établies hors de l'Union européenne. Ces plateformes auront interdiction totale à la publicité, et les influenceurs qui s'y risqueraient seront sanctionnés d'une amende. La loi doit à présent passer en commission mixte paritaire, d'ici l'hiver. La France pourrait bien ouvrir une voie mondiale en légiférant cette industrie.
- L'industrie de la mode représente entre 4% et 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
- En 2022, Greenpeace a révélé la présence de phtalates, un perturbateur endocrinien reconnu, dans de nombreux vêtements de l'entreprise Shein.
- Le 10 juin dernier, le Sénat a voté à l'unanimité une proposition de loi pour lutter contre la fast-fashion, elle doit à présent passer en commission mixte paritaire d'ici l'automne-hiver.