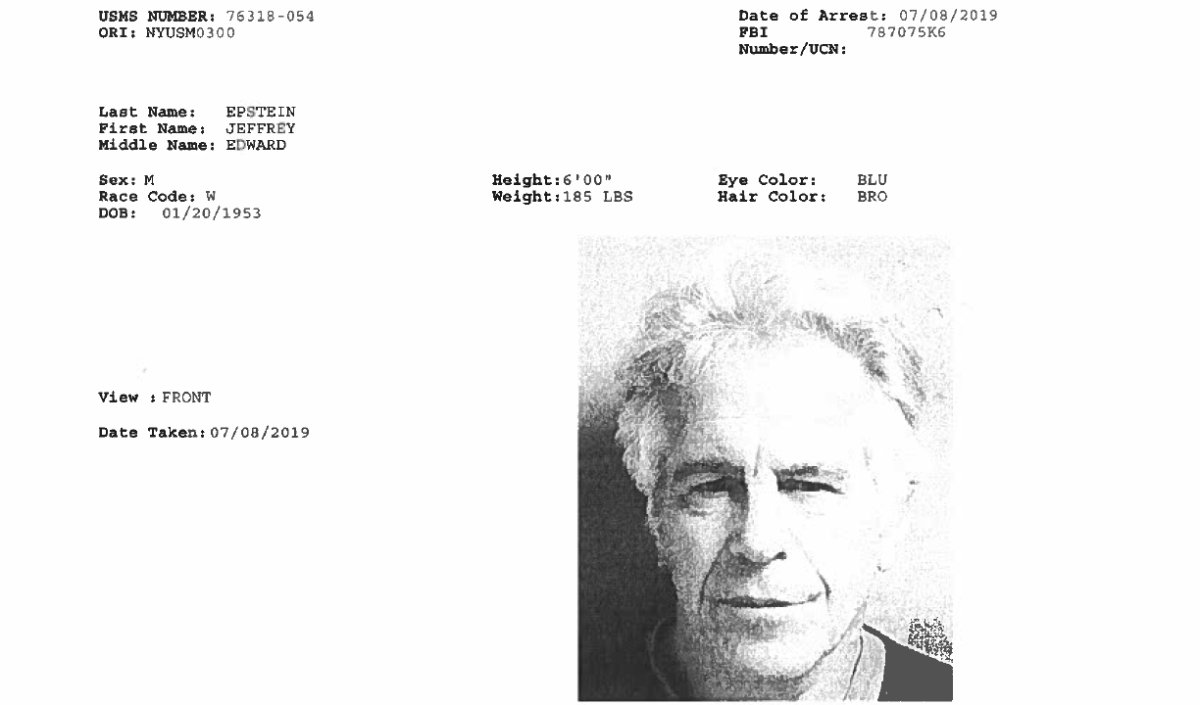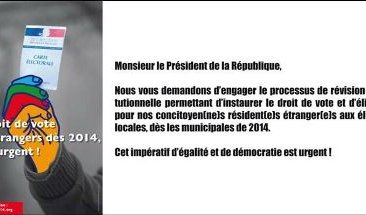L'État de Palestine, reconnu par Emmanuel Macron, reste hypothétique
Au siège de l'ONU, à New York, le 22 septembre, Emmanuel Macron a reconnu officiellement l'État de Palestine. Cette reconnaissance par la France a été précédée ou suivie par une petite dizaine d'autres États membres de l'ONU, dont le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, qui rejoignent ainsi la position déjà adoptée par quelque 150 pays. Ces ralliements sont consécutifs à la « déclaration de New York » du 12 septembre dernier, consacrant un vote largement majoritaire en faveur d'une solution à deux États pour régler le conflit israélo-palestinien. Sans surprise, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, s'est déclaré catégoriquement opposé à ces nouvelles reconnaissances, les qualifiant de « récompense colossale au terrorisme », et ne cachant pas sa colère à l'encontre de la France, dont l'influence aurait entraîné le choix d'autres pays occidentaux.
Désormais, la Palestine est reconnue par 158 pays (sur 193 représentés à l'ONU), dont 4 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité : la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine. Mais les États-Unis s'y refusent, Donald Trump jugeant le moment inopportun, contrairement à Emmanuel Macron selon lequel « le temps est venu ». Un veto américain peut bloquer toute proposition des autres membres permanents, par exemple celle d'accorder à la Palestine l'adhésion pleine et entière à l'ONU. En effet, si la Palestine bénéficie depuis 2012 du statut d'état observateur non-membre, sa reconnaissance par une majorité d'états n'en fait pas pour autant un état souverain.
En France, les réactions à l'initiative du président de la République sont également sans surprise. Marine Le Pen a qualifié cette reconnaissance de « faute grave », tandis que l'opposition de gauche s'en réjouit, mais pointe l'inefficacité de cette reconnaissance symbolique, pour arrêter les actions militaires israéliennes à Gaza et les implantations de nouvelles colonies en Cisjordanie. Le fait est que, si les combats se sont interrompus à Gaza, c'est sous la contrainte imposée par Trump à Nétanyahou.
Intervenant à son tour à la tribune des Nations Unies le 23 septembre, le président américain a fustigé les « mots creux » de celles-ci, qui ne l'ont « même pas aidé » dans ses efforts en faveur de la paix. Il a aussi dénoncé les alliés des États-Unis qui venaient de reconnaître un État palestinien, au lieu de se concentrer sur la libération des otages du Hamas. Dans le texte qu'Emmanuel Macron a signé au nom de la France, il est bien question de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza, mais seulement comme préalable à d'éventuelles négociations sur l'avenir de la Palestine. Le Hamas en serait exclu, ce qui ne devrait pas inquiéter outre mesure cette organisation terroriste.
En revanche, l'ultimatum musclé brandi par Donald Trump pour que les otages soient libérés semble plus persuasif. Le Hamas a déclaré le 4 octobre être prêt à libérer tous les otages (« vivants ou morts »), sans toutefois mentionner son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, autres points clés du plan Trump, dont l'exécution signerait la défaite du Hamas. Néanmoins, Donald Trump en a conclu que le Hamas était prêt à une paix durable, et a appelé Israël à « arrêter immédiatement les bombardements » à Gaza. Avec d'autres chefs d'État – y compris le pape Léon XIV (Vatican News, 5/10/2025) –, Emmanuel Macron a salué une « occasion décisive » de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas : « La libération de tous les otages et un cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main ! » s'est réjoui le président français (Le Figaro, 3/10/2025). Des négociateurs israéliens se sont rendus au Caire, ainsi que l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, pour entamer, ce lundi 6 octobre, des négociations avec le Hamas en vue de la libération des otages israéliens (France info, 5/10/2025).
Dans la presse internationale, la plupart des commentateurs s'accordent sur la nature symbolique de la reconnaissance d'un État palestinien. Les uns pour s'en féliciter, les autres pour la déplorer. Ils reconnaissent le rôle moteur joué par la France, en l'attribuant souvent à une « posture morale » sur la scène internationale, et à la pression qu'elle subit en interne par sa population issue de l'immigration (Courrier International, 23/09/2025).
Dans un débat organisé par Public Sénat (27/09/2025), le général Christophe Gomart, ancien patron du renseignement militaire français et député européen du Groupe PPE, juge que la reconnaissance de l'État palestinien par le président de la République est une triple faute : « ... politique parce que [...] les conditions ne sont pas réunies [...], morale parce qu'il donne raison au Hamas […], sécuritaire… », car il ressort des sondages que les Français sont profondément divisés sur l'opportunité de cette reconnaissance (cf. BFMTV, 20/09/2025 ; IFOP, 19/06/2025).
Interviewé par Atlantico (en lien ci-dessous), Dov Zerah, haut fonctionnaire, ancien professeur à Sciences Po, à l'ENA et à HEC, estime que cette reconnaissance de l'État de Palestine intègre insuffisamment la situation sur le terrain.
Au siège de l'ONU, à New York, le 22 septembre, Emmanuel Macron a reconnu officiellement l'État de Palestine.
Cette déclaration a suscité la colère du Premier ministre israélien contre la France, dont l'initiative aurait influencé plusieurs pays occidentaux.
Donald Trump, à l'ONU, a dénoncé l'impuissance des Nations Unies, et l'inopportunité de ces nouvelles reconnaissances qui ne posent pas en préalable la libération des otages du Hamas.
En imposant son plan de paix à Israël et au Hamas, le président américain oppose son réalisme à l'idéalisme onusien.