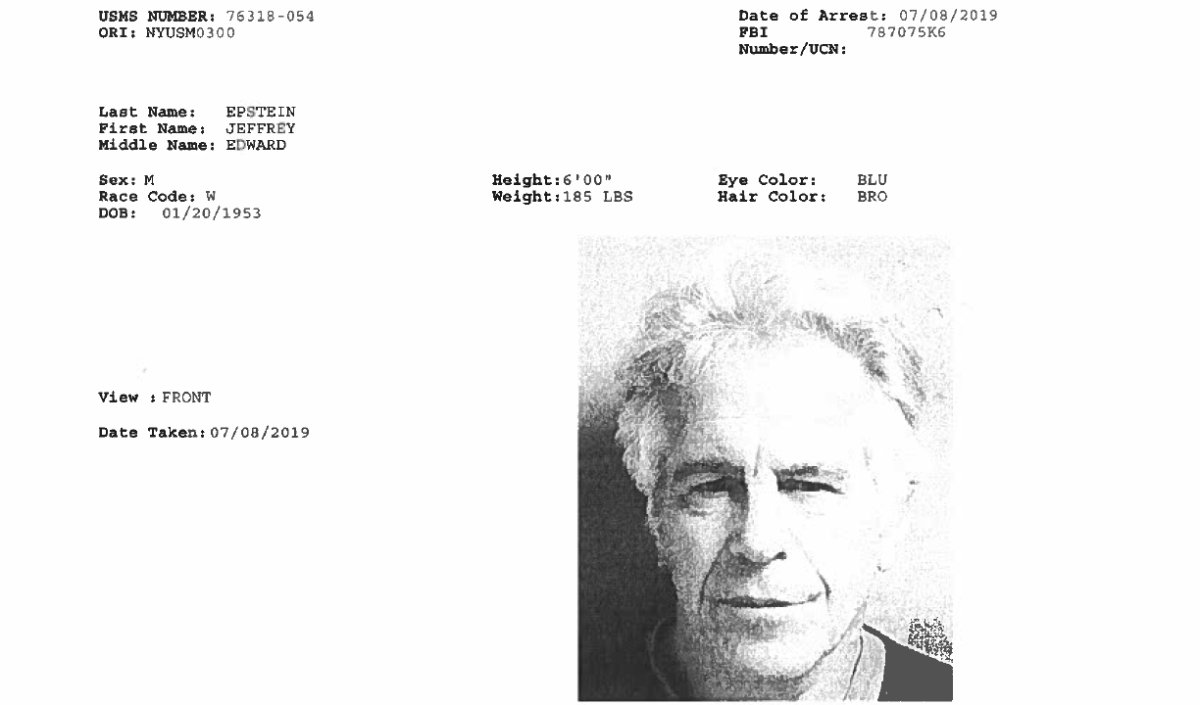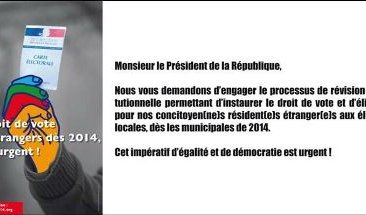Santé mentale et précarité sociale : la double peine des malades
C'est l'histoire d'un serpent qui se mord la queue. La tête, c'est la maladie mentale, et la queue, la précarité. Ou l'inverse d'ailleurs, peu importe. Dans tous les cas, en se gardant de trop de généralités, on peut dire que les deux sont intimement liés. La maladie mentale peut provoquer la précarité si la personne n'est pas très accompagnée, quand la précarité nourrit la maladie mentale. Les acteurs sur le terrain, que ce soit pour l'engagement social ou la santé, le constatent chaque jour.
Les troubles de santé mentale chez les salariés représentent la première cause des arrêts de travail longue durée (selon le Baromètre Teale de la santé mentale des salariés, 2023) et le phénomène progresse chaque année. Dans un rapport de la HAS (Haute Autorité de Santé) daté de septembre 2021, on peut lire : « les troubles psychiques, et en particulier les troubles sévères tels que les psychoses, tendent à précariser les personnes en altérant leurs capacités relationnelles et sociales ; la précarité est source de souffrance et de stress et tend à fragiliser les personnes sur le plan psychique ». Cette constatation du lien entre santé mentale et précarité est corroborée par une étude souvent citée, l'étude SAMENTA (pour SAnté MENTale et Addictions chez les personnes sans logement personnel d'Île-de-France), menée par le Samu social en 2009. Elle montrait qu'un tiers des personnes vivant dans une précarité extrême souffraient de trouble anxieux sévère et de dépression, et que, dans cette même population, les troubles psychotiques (psychose, schizophrénie, délire psychotique) sont dix fois plus répandus que dans la population globale. Ce constat date de 2009, et les choses ne se sont malheureusement pas arrangées, puisque la précarité augmente en France : de 90 000 personnes sans domicile en 2001, on est passé à 140 000 en 2012, puis à 300 000 en 2020.
Autre source, mais même constat dans cet article de Habitat et Humanisme, qui constate un lien très étroit entre précarité, santé mentale et addictions. En effet, un tiers de la population mal logée souffre de troubles psychiatriques sévères, c'est-à-dire de troubles psychotiques, troubles de l'humeur, et troubles anxieux. De plus, « pour les personnes atteintes de troubles psychotiques et de l'humeur, le risque de rupture sociale est dix fois plus important que pour la population générale. »
Une fois que l'on a dressé ce triste tableau, que fait-on ? On se tourne vers les acteurs du monde de la santé et du social qui font, sur le terrain, un travail formidable… malgré les difficultés. Et des difficultés, il y en a, à commencer par la première : à qui adresser une personne qui va mal, et en précarité ? Sous réserve que l'on ait réussi à l'identifier et à la contacter. Car son « dossier » est à la fois administratif – autant dire que la carte vitale n'est pas forcément à jour –, social et médical. Dans le rapport de la HAS précédemment cité, on peut lire aussi le sentiment d'impuissance des professionnels qui, parfois, peuvent céder à la « stratégie de la patate chaude ». Mais parmi les solutions qui existent…
Les équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) sont encadrées et organisées par une circulaire de 2005. Elles ont pour mission d'aller au-devant des personnes en situation de grande précarité présentant des troubles psychiques.
Le dispositif « Un chez-soi d'abord » est expérimenté en France depuis 2010, et inspiré du projet « Housing First », initié à New York dans les années 1990. Le principe : proposer d'emblée un toit à la personne à la rue et en état de détresse psychique. Sans étape intermédiaire ni condition de traitement ou d'arrêt de consommation de substances psychoactives s'il y en a. L'objectif ? Miser sur le cercle vertueux suivant : quand la personne n'a plus le souci permanent de survivre puisqu'elle est sortie de la précarité, elle trouve alors des ressources insoupçonnées pour se soigner d'un point de vue mental. Pour aller de pair avec ce dispositif, un suivi médical intensif est ensuite proposé.
De nombreuses associations, soutenues par la Fondation Sisley d'Ornano, œuvrent aussi pour la réinsertion des personnes présentant des troubles mentaux. Certaines à l'expertise reconnue. La Fondation Falret existe depuis deux siècles, avec des actions assumées dans cinq domaines : hébergement, logement et vie sociale, emploi, prévention et entraide, et préservation des droits. Autrement dit, tout ce qui manque à une personne dans la rue qui ne va pas bien. Même combat pour Club House France, qui revendique aussi être « un chaînon essentiel au rétablissement pour les personnes concernées par un trouble psychique. C'est une passerelle entre le soin et une vie active. Les 3 missions de l'association : sortir de l'isolement les personnes concernées, les accompagner vers une réinsertion sociale et professionnelle, faire changer le regard de la société sur la santé mentale. »
Gageons que cette année 2025, consacrée à la santé mentale, peut faire avancer les choses et donner aux acteurs de terrain les trois choses dont ils ont besoin : des moyens, des moyens et des moyens.
- Les maladies mentales sont la première cause des arrêts de travail longue durée.
- En France, les personnes SDF sont en majorité d'origine étrangère, et ont vécu dans leur pays d'origine des événements parfois traumatisants.
- Les troubles psychotiques multiplient par 10 le risque de rupture sociale.
- L'assurance d'avoir un toit sur la tête est un facteur majeur de bonne santé mentale.