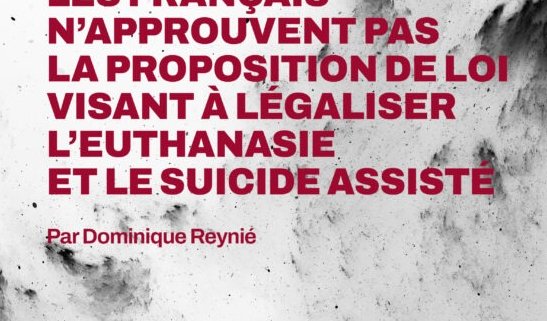RATP et retraites : privilèges en sous-sol
Car, hors de tout fantasme, les chiffres parlent d'eux-même : être à la RATP, c’est une pension de retraite s'élevant en moyenne 3.705 euros, contre 2.206 euros pour un fonctionnaire d’État. Comparés aux anciens salariés du secteur privé des transports, les retraités de la RATP ont une pension supérieure de 24 %. Ils ont surtout un taux de remplacement (la part du dernier salaire touchée en arrivant à la retraite) qui atteint le niveau record de 88%, contre 75% en moyenne dans le public et seulement 50% dans le privé. En moyenne, l’âge auquel les agents liquident leurs droits est de 55,7 ans à la RATP, contre 63 ans dans le privé, et plus de 61 ans dans le public, selon la Cour des comptes dans un rapport de juillet dernier. La RATP, c’est aussi une caisse de retraite déficitaire à hauteur de 736 millions d’euros par an, soit 11 euros par Français et par an utilisés pour maintenir tous ces avantages.
Au vu de tout cela, impossible de ne pas comprendre les raisons de faire grève des salariés de la RATP. Mais le souci est qu'ils sont sans doute parmi les plus mal placés pour le faire, comparés à tant d’autres salariés du secteur public (santé, éducation, armée, police…) ou du privé. Pourtant, plus largement, les fondements même de cette réforme constituent une véritable bombe à retardement : sous l’apparence d’une réforme égalitaire, l’instauration d’une retraite à points pour tous les Français ne doit pas masquer que, finalement, c’est à l’État que reviendra le privilège de fixer la valeur de ce point. Une valeur qu’il suffira, un jour ou l'autre, inévitablement, de ne pas augmenter… ou de réduire. Demain, des retraites dévaluées, mais pour tous ? Sans aucun doute.