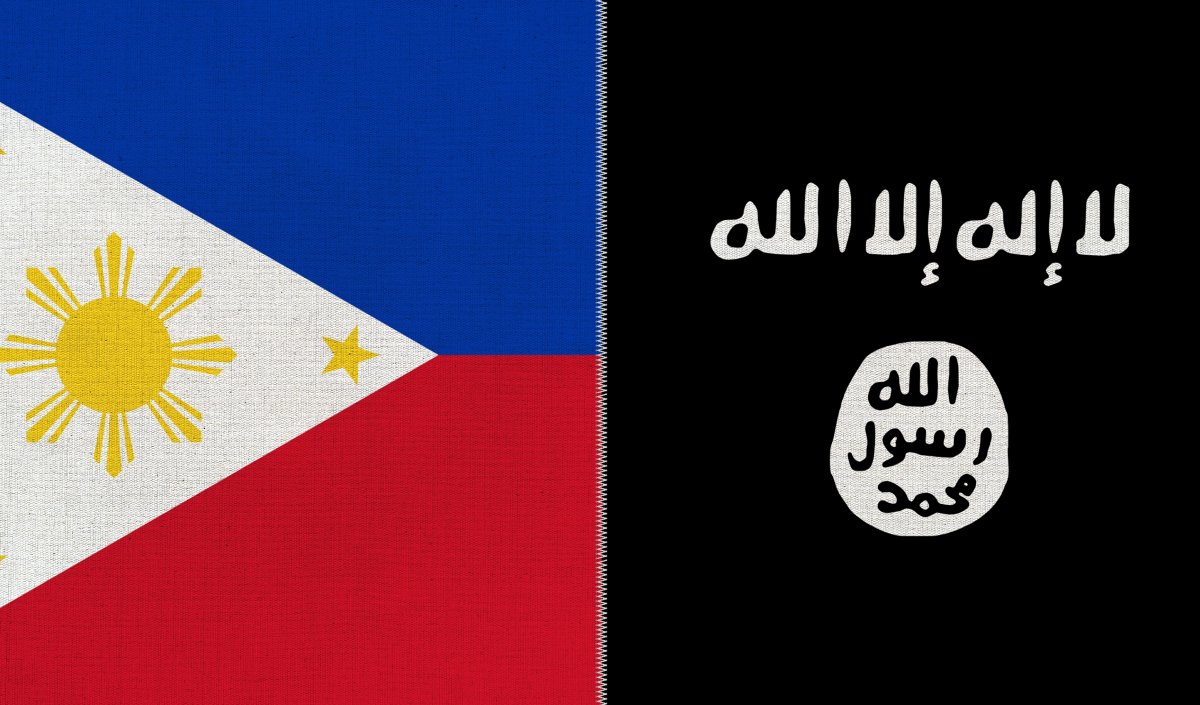Un Français sur deux voudrait rétablir la peine de mort
Clamant sa fierté d'aller à l'encontre de l'opinion publique, qu'il jugeait mal éclairée sur le sujet, celui qui fut garde des Sceaux sous François Mitterrand refusait le recours au référendum. Robert Badinter obtint le vote des députés en faveur de l'abolition, le lendemain d'un discours mémorable à l'Assemblée nationale (notre sélection). Le pouvoir dissuasif des exécutions était nul, faisait-il observer, prenant pour preuve que « toutes les recherches des criminologues » constataient l'absence de liens entre leur pratique et l'évolution de la criminalité sanglante. Le sang versé en retour renforcerait la spirale de la vengeance tout en pointant l'infamie : « Dans les pays de liberté, l'abolition est presque partout la règle ; dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. » En partie vrai, au regard des endroits où elle est en vigueur : Iran, Arabie Saoudite, Algérie, Chine… même si les États-Unis auront peu apprécié sa diatribe. Il ajoutait un argument voulu lapidaire : « Ceux qui veulent une justice qui tue, admettent une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. » Ce serait là « la vraie signification politique de la peine de mort, l'empreinte du totalitarisme procédant de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui retirer la vie ». Étrange paradoxe que l'État français abolitionniste veuille désormais contraindre les professionnels de santé à faciliter une « aide à mourir ».
Aujourd'hui, 62 % des Français ne font plus confiance à la justice du XXIe siècle, que Robert Badinter prétendait inaugurer. Et un sur deux souhaiterait rétablir la peine capitale.
Le sujet fait débat, même chez les chrétiens. Saint Paul semble l'autoriser (Romains 13, 3-4), bien que le Christ invite à dépasser la loi du Talion : « Vous avez appris qu'il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. […] Et moi je vous dis : Aimez vos ennemis […], faites du bien à ceux qui vous haïssent […]. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? » (Matthieu, 5, 38-46). Lui-même pardonne à ses bourreaux sur la croix. Mais d'autres passages le montrent tranchant quant à ceux qui scandalisent « l'un de ces petits » : « Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou la meule qu'un âne tourne, et qu'on le précipitât au fond de la mer. » (Matthieu, 18, 6). Pour sa part, le Magistère de l'Église catholique n'avait jamais pleinement interdit la peine de mort… jusqu'au Pape François.
Le pontife argentin l'a fait formellement bannir du Catéchisme, amendant son article n° 2267 pour enseigner que « la peine de mort est inadmissible, car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité de la personne. » Il réfutait, par ailleurs, qu'on la conçoive comme une légitime défense, puisqu'elle s'applique à « des personnes dont la capacité d'infliger un préjudice [...] a déjà été neutralisée, et qui se trouvent privées de leur liberté ». François est allé plus loin, soupçonnant la réclusion à perpétuité d'être une « peine de mort déguisée ». En 2013, le Vatican l'a supprimée de son code pénal et remplacée par une incarcération maximale de 35 ans. Léon XIV semble aligné sur son prédécesseur : reprochant une incohérence aux militants anti-avortement qui soutiendraient les exécutions.
Mais quelle est la valeur doctrinale d'un décret qui se distance de la quasi-totalité des successeurs de Pierre ? En 1952, Pie XII défendait une autre interprétation : « L'État ne dispose pas du droit de l'individu à la vie. Il est réservé alors au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie, en expiation de sa faute, après que, par son crime, il s'est déjà dépossédé de son droit à la vie. »
La position de Jean Paul II est plus nuancée. Il avance que la suppression du coupable devrait intervenir seulement « en cas de nécessité absolue, lorsque la défense de la société ne peut être possible autrement. Aujourd'hui, cependant, à la suite d'une organisation toujours plus efficiente de l'institution pénale, ces cas sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants. » (Evangelium Vitae n° 56).
L'Église décèle, dans les longues années passées derrière les barreaux, une opportunité de repentance. Il reste utile de rappeler combien certains condamnés ont trouvé la rédemption dans leur verdict. Du bon larron à Henri Pranzini, jusqu'à Jacques Fesch, guillotiné en 1957, après avoir vécu une conversion radicale en prison. « Puisse mon sang qui va couler être accepté par Dieu comme un sacrifice entier, que chaque goutte, écrit-il dans un livre légué à sa fille, serve à effacer un péché mortel. » Et de conclure, « dans 5 heures, je verrai Jésus ».
Peut-être, in fine, que la vraie question autour de la peine de mort n'est pas celle de son rétablissement, mais de pallier à ce que pointent tant d'avis favorables : une société où les coupables échappent à la loi. 62 % des Français affirment que leur sécurité est mal assurée. Et 78 % que la justice fait preuve de laxisme. Déjà faudrait-il que les peines de perpétuité s'appliquent...
Victor Hugo se lamentait du sort de son personnage, dans une œuvre poignante qui aura marqué des générations d'écoliers. D'aucuns regrettent qu'il n'y ait pas dédié une page aux victimes.
- Un Français sur deux est toujours favorable à la peine de mort, et 62 % des Français ne font plus confiance à la justice.
- Le sujet fait débat chez les chrétiens, surtout depuis qu'elle a été déclarée inadmissible par le pape François.
- Il s'agit du premier pape à adopter cette position dans l'histoire de l'Eglise. Jean-Paul II la déclarait possible en cas de nécessité absolue, lorsque la défense de la société ne peut-être assurée autrement, tout en précisant que ces cas sont aujourd'hui très rares.
- Avec une justice plus efficace et des peines de perpétuité réelles, la peine de mort trouverait-elle moins d'échos positifs dans l'opinion ?