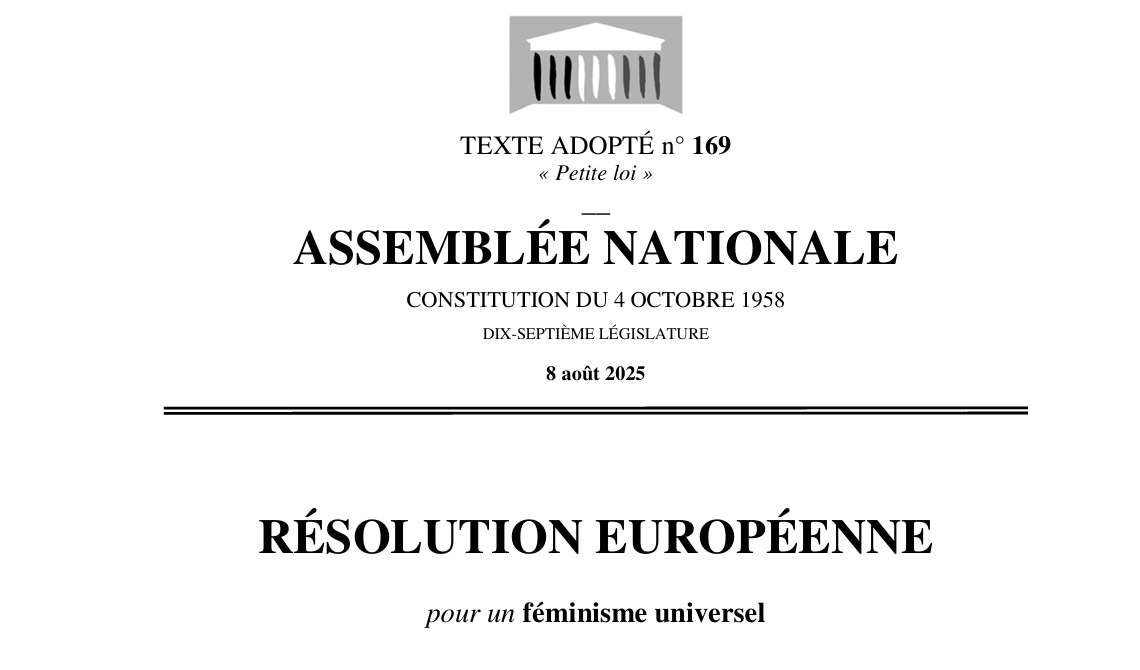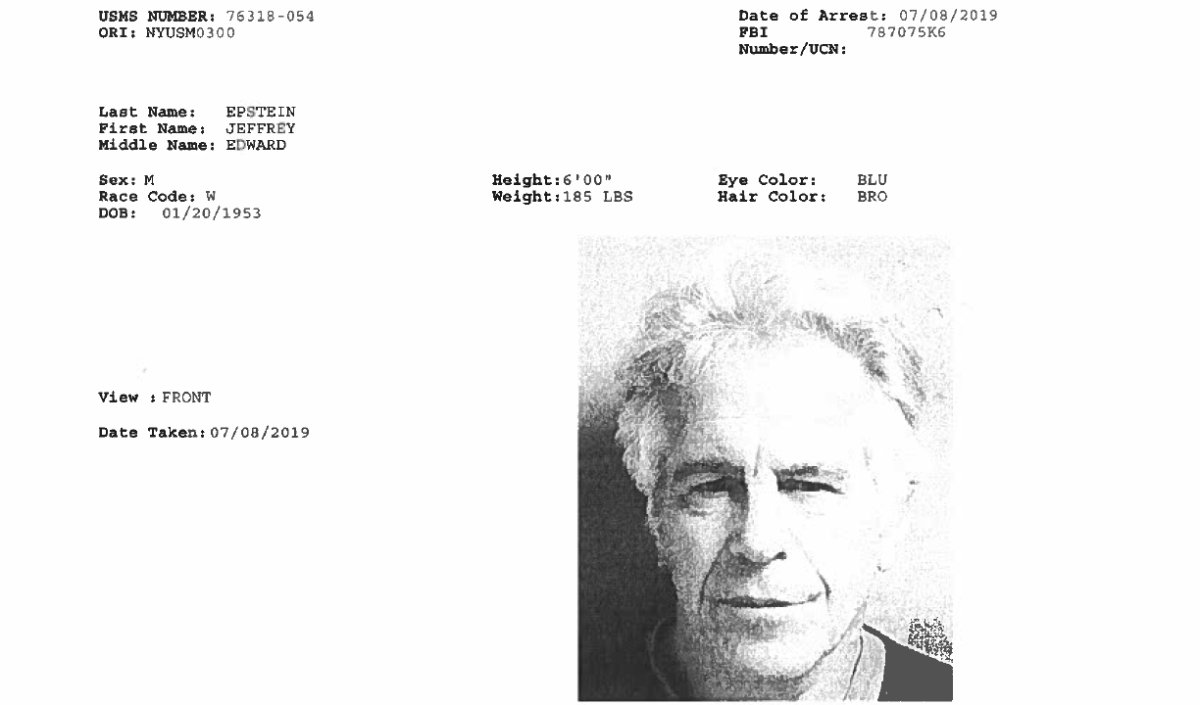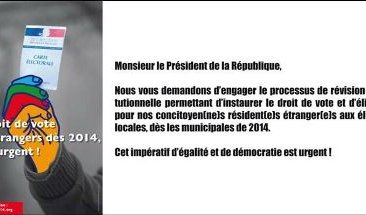L'Assemblée Nationale a défini ce qu'est une « bonne féministe », et bien plus...
Passé relativement inaperçu, un texte (découlant d'une résolution européenne), censé définir un « féminisme universel », a été adopté par l'Assemblée nationale le 8 août. Il ne s'agit pas ici de règles techniques, mais bien d'une vision qui se veut contraignante et coercitive, autrement dit, d'une idéologie d'État, historiquement marqueur des régimes totalitaires. Pour commencer, le texte prétend « refuser toute instrumentalisation politique » (dans un texte politique, cela paraît cocasse), tout en « affirmant que la laïcité et l'égalité sont les garanties de la liberté des femmes ».
Sécularité et laïcité sont deux notions souvent confondues. La sécularité désigne la séparation du politique et du religieux. La laïcité, sa version française, va plus loin, car elle efface toute référence historique ou spirituelle commune, au nom d'un idéal de neutralité absolue, interdisant toute continuité avec le catholicisme qui a façonné la France pendant plus de 1 500 ans. Ce pays est le seul au monde à appliquer la sécularité de cette manière, sur le principe de la table rase. Personne n'a fait ce choix, cela n'existe pas ailleurs. Par la suite, le texte semble dater la naissance du féminisme avec la République. Christine de Pizan, Marie de Gournay, Gabrielle Suchon, Louise Labé, Olympe de Gouges et tant d'autres apprécieront sans doute qu'on les efface de la sorte. Dire que tout cela est une suite logique semble relever de la solution de facilité, pour légitimer un discours choisi. L'histoire française regorge de femmes qui, dans des contextes peut-être plus périlleux qu'aujourd'hui, se sont levées, souvent au prix de leurs vies. Une perception qui semble orientée pour renforcer le cadre politique actuel, le posant alors comme seule matrice de liberté. Alors que l'Espagne, par exemple, en vue en ce moment, est une monarchie constitutionnelle.
Le texte prend des accents pamphlétaires, lorsqu'il affirme que « le féminisme universel reconnaît et embrasse la diversité des expériences et des identités féminines », tout en ajoutant qu'il doit agir « sans céder aux dérives identitaires ou sectaires ». Qu'est-ce qu'une « dérive identitaire » ? Au-delà d'une arme qui permet d'exclure arbitrairement. Comment l'interpréter, quand être une femme est devenu une question en soi (demander « qu'est-ce qu'une femme ? » est considéré comme piégeux), et que le texte n'en donne pas de définition ? Refuser la version biologique, c'est renvoyer la notion de « femme » à l'auto-définition subjective, mouvante, conceptuelle et donc instrumentalisable. Ce qui aboutit à inclure des hommes à travers, par exemple, les « gender fluid ». Des questions qui divisent au sein même de la communauté LGBT, certains considérant que les nouveaux venus invisibilisent les anciens. Beaucoup semblent découvrir l'absurdité de la notion d'identité, pourtant au cœur des questionnements humains et de la philosophie depuis toujours. Alors, peut-être avons-nous trouvé une réponse définitive. Si tel est le cas, sabrons le champagne, car nous venons de résoudre une question existentielle majeure.
L'exclusion d'un collectif de manifestations féministes est évoquée. On aurait pu penser au cas de Némésis, mais non, il s'agit de « Nous Vivrons », qui ne se dit pas féministe mais engagé contre l'antisémitisme. Né après les attaques du 7 octobre, ce groupe avait été écarté parce qu'il entrait en contradiction avec l'intersectionnalité. Et comme cette « convergence des luttes » hiérarchise les causes, il a fallu choisir et, ce jour-là, la cause palestinienne a été placée au-dessus de celle des femmes juives massacrées. Némésis s'inscrit dans le même schéma de persécution et d'exclusion : identitaire, patriote, ses positions vont contre l'idéologie médiatique dominante. Un tel collectif pourrait être taxé de « dérive » ou de « sectaire » et donc interdit, alors même que le texte proscrit l'exclusion de tout « groupe de femmes pour ses convictions ». Ce texte implique donc une dimension d'acceptabilité des convictions. Laquelle conditionne en plus l'accès aux financements européens par une nouvelle « procédure de filtrage systématique ». Le texte va jusqu'à inviter l'État à refuser ou retirer les subventions aux acteurs dont le combat « pourrait stigmatiser, inférioriser ou appeler à la haine », et donc « remettre en cause l'universalité du féminisme ».
Ce texte prend parti pour certains acteurs d'un courant se réclamant d'une « gauche révolutionnaire ». Or, si cette gauche est désormais alignée sur les institutions, elle n'est plus en révolte, elle est le pouvoir. De plus, ces militants dits « néo-féministes » soutiennent souvent des causes portées par l'UE : climat, droit des migrants, sans-frontiérisme... Mais le sans-frontiérisme idéologique s'accompagne de son pendant économique, qui est le mondialisme, donc l'ultra-capitalisme. En fin de compte, il se pourrait bien qu'ils militent pour renforcer le pouvoir d'une élite mondiale qu'ils pensent combattre. Postulat défendu par Léna Rey, pour qui ce néo-féminisme serait une création du capitalisme. Ce « féminisme universel » n'embrasse donc pas la diversité, il en impose une vision mondialisée. Mis en perspective avec le nouveau « ministère de la vérité » Européen et le projet de loi chat control... cela devient explosif.
- Création d'une idéologie d'État contraignante et coercitive autour d'une définition européenne d'un " féminisme universel ". L'Assemblée nationale entérine donc une vision idéologique, politique et normative du féminisme.
- Le texte s'appuie sur la laïcité française, principe pourtant unique au monde, à ne pas confondre avec la sécularité.
- En rattachant le féminisme à la République, il efface les figures et combats féminins pré-républicains, pour légitimer le cadre politique actuel. Entreprise d'effacement historique au profit d'un discours choisi.
- Aligné sur les idéaux LGBTQUIA+ et progressistes, le “ féminisme universel ” s'inscrit dans une logique mondialiste : il n'émancipe plus, il normalise. Une gauche qui se veut " révolutionnaire ", pourtant alignée avec les institutions.