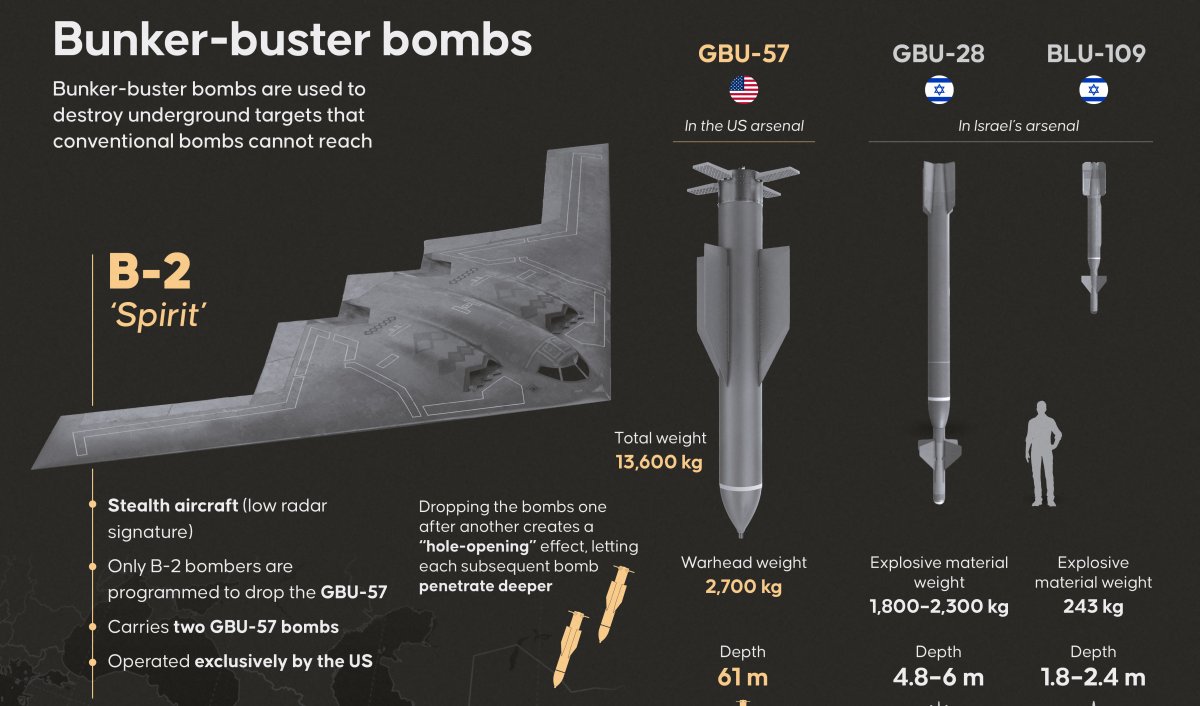L'Apocalypse selon Saint-Jean Raspail
Ce poète n’était pas seulement taillé dans le roc de ses certitudes – un mot aujourd’hui synonyme d’extrémisme. Il était à l’aventure ce que Jean Piat était au théâtre, un homme innervé par sa passion. Après deux années de Droit, il y succomba : « Mes universités, ce sont mes voyages », disait-il. En 1948, il partit de Québec à bord d'un canoë avec trois camarades et, sur les traces du père Marquette, rejoignit la Nouvelle-Orléans, via les Grands Lacs et le Mississippi. Il y a des hommes comme ça – qui se trompent de siècle. Jean Raspail naquit dans un monde fini, clos sur sa géographie. Heureusement, il y avait la plume. À lui tout seul, il était d’ailleurs un personnage de roman. Trop carré pour se mouler dans un autre costume que le sien. Ne s’était-il pas fait roi lui-même, par procuration, à travers son double narcissique, l’improbable Antoine de Tounens, ce Français devenu monarque en Patagonie ? L’écrivain était peut-être trop fier, trop indépendant, pour réussir à courtiser les mandarins de l’Institut. L’immortalité ne viendrait jamais, malgré ses Grands prix de l’Académie française. Pourtant, il l’aurait méritée car ses héros se jouaient finalement du temps comme de l’espace. Ses territoires étaient des catégories de l’esprit, des « ailleurs ». Malgré son étiquette d’« ultraréactionnaire attaché à l’identité et au terroir », Jean Raspail était de ces nomades qui confondent le voyage et la fuite, enraciné dans ce mouvement perpétuel qui fait de vous un ennemi de la société telle qu’elle est. De ce point de vue, notre écrivain est le produit de son époque, désenchantée, habité par des phobies, comme dans Septentrion, ce paradis blanc introuvable à l’abri de la malédiction du Sud. Jean Raspail avait voyagé en Amérique où le spectacle de civilisations disparues le traumatisa. Cela n’arrive pas qu’aux autres. Avec son titre prélevé dans l’Apocalypse, Le Camp des Saints (Robert Laffont, 1973) relève de la plus épouvantable dystopie. Une certaine lecture donne à penser que sa prophétie se réalise tous les jours un peu plus, jusque dans la réplication des lieux, quand en 2001 un cargo chargé d’immigrants kurdes s’échoua sur sa plage de Boulouris (Var). Ce « roman-culte » des milieux droitisants, huit fois réédité, racontait l'arrivée, une nuit, sur les côtes du sud-est de la France, de cent navires chargés d'un million de miséreux venus de Calcutta. Combien de millions sont-ils aujourd’hui ? À Dijon, l’espace Schengen devient l’espace tchétchène. Quant au business des Traoré, ce sont des « petits blancs » bien bourgeois (et des femmes qui s’appellent Marie, Camille ou Chloé) qui donnent le plus à la cause de ces Dalton de banlieue. Ces situations, diront certains, font écho au Camp des Saints :
D'abord, ce roman d’anticipation divise l’humanité entre « eux » et « nous », à une époque où l’immigration n’obsédait pas les esprits. Comme Le Monde l'écrit, cette oeuvre « pousse à choisir son camp ». En y venant chercher l’espérance, les étrangers vont « nous » engloutir à jamais. Leur seule force, c’est leur nombre : on ne lutte pas contre un tsunami.
Ensuite, Jean Raspail, dans sa solitude choisie, exècre toute forme d'effusion universaliste. Lui, l'écrivain-voyageur, qui n'aurait rien écrit sans les contrées lointaines, refusait l'idée que le mouvement ne partît plus de l'Europe. Cela le rendait incompatible avec les élans de l’après-Vatican II. Jusque-là, le catholicisme se perpétuait à travers des rites familiaux et familiers. Son évidence en faisait le pilier de la réassurance collective. Jean Raspail méprisait cette morale qui conduisit à se défaire de soi-même au nom de l’ouverture à autrui. Le Camp des Saints, c’est l’éternelle histoire du cheval de Troie. Envahi de l’extérieur, on est toujours vaincu de l’intérieur, par ses propres démissions. Cette idée, l’écrivain la relayait dans La patrie trahie par la République, tribune parue dans Le Figaro en 2004. Ce texte affreusement décliniste et anxiogène fit scandale.
En 2015, Jean Raspail donna une interview au Point. Sur Le Camp des Saints, il se fit comme Saint-Jean : « C'est un livre surprenant. Il a été long à écrire, mais il est venu tout seul. J'arrêtais le soir, je reprenais le lendemain matin sans savoir où j'allais. Il y a une inspiration dans ce livre qui est étrangère à moi-même. Je ne dis pas qu'elle est divine, mais étrange ». Fantasme ou réalité ? Décidément, les milieux royalistes aiment les divines surprises. On ne saura jamais si Dieu avait pris comme porte-parole le consul général de Patagonie.